Cet article reprend en grande partie la communication de Giuseppe A. Samonà au Xème Leonardo Sciascia Colloquium organisé par l’association Amici di Leonardo Sciascia, qui s’est tenu les 21 et 22 novembre 2019 à l’Institut Culturel Italien de Paris, et intitulé «Exercices d’admiration. Regards obliques: Sciascia et les ‘irréguliers’ du vingtième siècle». Sa version complète paraîtra en 2020, avec l’ensemble des Actes du colloque, dans Todomodo. Rivista internazionale di studi sciasciani. Cette réflexion vient s’ajouter à l’hommage que notre site Altritaliani a voulu rendre au grand écrivain sicilien à l’occasion de la commémoration des 30 ans de sa mort (voir Dossier Sciascia 30 anni dopo).

***
Il y a une nouvelle de Sciascia qui semble une variante, ou mieux, le pendant sicilien de la sublime Choutotchka d’Anton Tchekhov, connue en italien sous le titre Uno scherzetto, en français Une petite plaisanterie, mais qu’on pourrait aussi traduire par une farce innocente, au sens de cette innocence à la fois légère et cruelle, voire sadique, qui est le propre des enfants et des amoureux. La nouvelle que j’évoque ici, imprégnée de cette idée tchékhovienne de l’amour entendu essentiellement comme nostalgie, est La mer couleur de vin (Il mare colore del vino), qui est aussi le titre du recueil tout entier.
 Ce texte contient une clef pour comprendre le sens et la place que Sciascia donne à la littérature, pour ainsi dire entre vérité et mensonge. La clef par ailleurs est celle qui explique, indirectement, le titre (celui de la nouvelle et celui du volume). Bref rappel : l’action se déroule dans le train de nuit qui va de Rome en Sicile, sur fond d’une romance innocente (au sens tchékhovien) entre un ingénieur du Nord, d’un peu moins de quarante ans, et une jeune fille d’une vingtaine d’années, accompagnée d’un couple plus âgé d’enseignants à l’école élémentaire, avec leurs deux enfants très mal élevés, tous du même village sicilien. C’est l’aube, on vient de traverser le détroit de Messine. (Qui a fait le voyage connaît le mélange de fatigue et d’émotion qu’on éprouve à ce moment du trajet.) Le «professeur» (c’est ainsi qu’on l’appelle dans le texte) exalte la beauté de cette mer – et Nenè (le plus petit et le plus infernal des enfants) commente : On dirait du vin… Comment est-ce possible ? La mer semble verte, plus loin bleue, bleu sombre, on entrevoit peut-être (commente la jeune fille) une trace rougeâtre… Mais de là à sembler du vin, il en faut : peut-être l’enfant est-il daltonien ? Nenè pourtant insiste: c’est du vin…. Même la cravate que lui montre son père (verte à rayures noires) a les couleurs du vin… L’enfant, en somme, est délibérément provoquant, ou si l’on veut, il ment. La mer, de toute évidence, n’a pas la couleur du vin, et pourtant… Voici (je cite, en traduisant) : « La mer couleur de vin : où l’ai-je entendu ? se demandait l’ingénieur. La mer n’est pas couleur de vin, le professeur a raison. Peut-être aux premiers moments de l’aurore, ou au coucher du soleil ; mais pas à cette heure-ci. Et pourtant, cet enfant a saisi quelque chose de juste : peut-être l’effet que produit, à l’instar du vin, une mer comme celle-ci. Elle n’enivre pas : elle s’empare de la pensée, éveille l’ancienne sagesse… »
Ce texte contient une clef pour comprendre le sens et la place que Sciascia donne à la littérature, pour ainsi dire entre vérité et mensonge. La clef par ailleurs est celle qui explique, indirectement, le titre (celui de la nouvelle et celui du volume). Bref rappel : l’action se déroule dans le train de nuit qui va de Rome en Sicile, sur fond d’une romance innocente (au sens tchékhovien) entre un ingénieur du Nord, d’un peu moins de quarante ans, et une jeune fille d’une vingtaine d’années, accompagnée d’un couple plus âgé d’enseignants à l’école élémentaire, avec leurs deux enfants très mal élevés, tous du même village sicilien. C’est l’aube, on vient de traverser le détroit de Messine. (Qui a fait le voyage connaît le mélange de fatigue et d’émotion qu’on éprouve à ce moment du trajet.) Le «professeur» (c’est ainsi qu’on l’appelle dans le texte) exalte la beauté de cette mer – et Nenè (le plus petit et le plus infernal des enfants) commente : On dirait du vin… Comment est-ce possible ? La mer semble verte, plus loin bleue, bleu sombre, on entrevoit peut-être (commente la jeune fille) une trace rougeâtre… Mais de là à sembler du vin, il en faut : peut-être l’enfant est-il daltonien ? Nenè pourtant insiste: c’est du vin…. Même la cravate que lui montre son père (verte à rayures noires) a les couleurs du vin… L’enfant, en somme, est délibérément provoquant, ou si l’on veut, il ment. La mer, de toute évidence, n’a pas la couleur du vin, et pourtant… Voici (je cite, en traduisant) : « La mer couleur de vin : où l’ai-je entendu ? se demandait l’ingénieur. La mer n’est pas couleur de vin, le professeur a raison. Peut-être aux premiers moments de l’aurore, ou au coucher du soleil ; mais pas à cette heure-ci. Et pourtant, cet enfant a saisi quelque chose de juste : peut-être l’effet que produit, à l’instar du vin, une mer comme celle-ci. Elle n’enivre pas : elle s’empare de la pensée, éveille l’ancienne sagesse… »
Sciascia, dans toute sa production, qu’elle soit directement policière ou non, est obsédé par le problème de savoir comment reconnaître, concrètement, la vérité – une vérité qui va évidemment bien au-delà des questions juridico-policières – et à plusieurs reprises il constate (pour reprendre les termes employés dans le Conseil d’Egypte) que très souvent la vérité se révèle confuse, tandis que le mensonge prend l’apparence de la vérité. Le devoir de la littérature est justement de dissiper cette confusion, en créant des liens imprévisibles et éclairants.
De quelle manière? Eh bien, par exemple, comme dans ce cas, en suggérant poétiquement, candidement, qu’une couleur peut déborder des registres qui lui sont propres pour concerner l’odorat, le goût, et aller jusqu’à produire l’ivresse, à travers ces débordements. Et puis il y a la mémoire. Mais où l’ai-je entendu ? se demande l’ingénieur, fouillant dans les brumes de ses souvenirs, de ses études peut-être, et saisissant quelque chose de vrai, quelque chose qui a un rapport avec l’antica saggezza.
Il ne s’agit pas de Platon, que l’ingénieur évoque juste après (Les dialogues de Platon, c’est Eduardo de Filippo qui devrait les réciter: en napolitain, remarque-t-il au passage), mais d’Homère, qui en revanche n’est pas nommé, et reste comme caché. Homère en effet définit la mer, çà et là, comme oinops pontos, c’est-à-dire du vin pour la vue, pour les yeux. Par ailleurs les hellénistes rappellent que pour les Grecs, pontos, la « haute mer », le large, c’est l’altérité par antonomase, tout comme le vin, précisément : une altérité qui est aussi, c’est évident, d’une simplicité, d’une familiarité inquiétante. Bref, même sans approfondir, on voit comment une brève formule littéraire est capable de saisir d’une manière fulgurante quelque chose de bien plus vaste que la simple réalité sensible. Ce n’est pas un hasard si cette formule apparaît ici, car elle souligne, de façon mystérieuse, l’altérité – aux yeux de qui arrive du Continent – de la Sicile elle-même.
Remarquez-le bien : l’ingénieur évoque le fait d’entendre, non de voir, c’est-à-dire de lire. Il vaut la peine de prêter attention à ces détails, qui sont tout sauf anodins. Sans entrer dans le labyrinthe de la question homérique, il faut au moins rappeler que le nom d’Homère recouvre et exprime un extraordinaire travail d’intelligence collective. Concrètement, ce que nous lisons est comme la partie émergée d’un iceberg constitué de traditions orales entrecroisées: l’écriture, en ce sens, serait l’excroissance « tardive » d’une longue tradition orale. Et comprendre la nature orale de l’Iliade et de l’Odyssée nous aide à mieux les lire.
Mais pour revenir à la mer couleur de vin : que sont les couleurs ? Que doivent-elles à la « nature », que doivent-elles à la « culture » ? Et quand cette dernière intervient, que peut-elle révéler? En effet – c’est connu – une grande partie de ce que nous voyons dépend, d’un côté, de ce que nous sommes en mesure, culturellement, de voir, et de l’autre de ce que nous voulons restituer, signifier de notre perception. Pour les Romains – autre exemple emprunté à l’Antiquité – l’or était moins jaune que rouge, d’un rouge ardent, rutilus… (et il y aurait bien d’autres exemples…).
Et la littérature, dans tout cela ? On pourrait dire qu’en assumant un mensonge (apparent, ou partiel) elle finit par saisir quelque chose de la vérité, d’une vérité autre, plus cachée. Il est intéressant de noter comment, quelques lignes plus loin, le professeur nie de fait l’existence de la mafia, en la définissant comme une bêtise, une invention du Nord, de la politique : car en effet, ainsi que le raconte Le jour de la chouette (Il giorno della civetta), l’une des stratégies fondamentales de la mafia, avec la complicité d’une partie des pouvoirs publics et l’assentiment plus ou moins délibéré d’une bonne frange de la population, a consisté à nier, tout bonnement, sa propre existence. A nouveau: la littérature, celle de Sciascia en premier lieu, a contribué à en démontrer la réalité.

Mais quel rapport avec Platon ? En schématisant à l’extrême pour arriver à l’essentiel, je dirais que Platon, justement, s’oppose à Homère, à ses mythes, aux récits multiformes dont se composent l’Iliade et l’Odyssée, et qui sont source – nous dit-il – de mensonge. Et à la parole mensongère du mythos, il oppose celle du logos, fondatrice de vérité. Pourtant, Platon lui-même n’hésitera pas à recourir à certains « mythes », même si c’est d’une autre manière qu’Homère; mais surtout, à l’instar d’Homère, il semble préférer à la parole écrite la parole orale, l’ineffable parole ailée, qui est justement la dimension propre au mythe (je fais allusion en particulier aux considérations développées dans le Phèdre et dans la Lettre VII).
Il y a en somme quelque chose de paradoxal. Platon, dont les écrits représentent un des moments culminants de l’histoire humaine, avait à l’égard de l’écriture, morte comme du marbre, une méfiance argumentée, à tel point – selon certaines interprétations – qu’il aurait confié la partie la plus précieuse de son enseignement à la parole ailée, vitale et multiforme. D’ailleurs, dans la Grèce des Ve et IVe siècles, qui possède désormais l’écriture, la transmission et la publication des œuvres continuent de toute façon à se faire oralement. Quoi qu’il en soit, cette réflexion de Platon marque une défiance vis-à-vis de l’écriture, une sorte de vision négative, sinon un véritable anathème, comme le dit Derrida (dans De la grammatologie), qui traverse toute la culture occidentale.
Ici – à propos de cette vision négative – je voudrais invoquer rapidement Rousseau et surtout celui qui s’en réclame, comme une sorte de disciple: Claude Lévi-Strauss (pour qui Rousseau serait le véritable fondateur de l’ethnologie).
Rousseau, qui déjà dans l’Emile déclare ne pas avoir envie de parler de l’écriture, qualifiée de niaiseries, dans son essai sur L’origine des langues, lui consacre quelques pages très denses. Pour résumer : le langage naît de la passion, des passions, il les signifie, il est initialement innocent, figuré, ou si l’on veut « originairement métaphorique » (la citation est encore de Derrida) … L’écriture ne fait que figer la langue, elle l’altère, elle ne traduit pas les sentiments mais les idées. En un mot, elle lui fait violence… (La référence au mythe de Bellérophon raconté dans l’Iliade est significative. Un anax, un roi, pour se débarrasser de lui, de Bellérophon, le charge de porter à un autre anax une tablette, sur laquelle sont tracés des signes funestes. Qui voit ces signes doit le tuer. C’est la seule allusion homérique à l’existence de l’écriture.)
Lévi-Strauss, dans Tristes tropiques (nous sommes en 1958) reprend cette idée, et, en quelques pages magnifiques, développe une véritable théorie sociale de l’écriture. En voici l’essentiel: la grande rupture dans l’histoire humaine, le grand saut à l’intérieur duquel nous sommes encore en train de progresser, est l’invention ou la découverte de l’agriculture et de l’élevage, un peu moins de dix mille ans avant notre ère. Des pas de géant, dans le sens de la civilisation, ont été accomplis pendant des millénaires sans l’écriture… La seule grande nouveauté qui apparaît en même temps que cette dernière, entre le quatrième et le troisième millénaire, et l’accompagne, est la formation des villes et des Empires, parallèlement à celle des sociétés stratifiées, divisées en classes. En somme, l’écriture serait l’instrument de la violence sociale, de l’exploitation de l’homme par l’homme, elle facilite l’asservissement (voir l’usage de la bureaucratie, le « fichage » des gens, etc.) – son autre usage, esthético-intellectuel, serait secondaire; ou plus exactement (Lévi-Strauss ici est provocant, même si c’est de façon positive) il ne serait que le masque du premier.
Et on pourrait même aller plus loin: quand nous pensons à la littérature, au sens de littérature écrite, nous devrions penser à une double invention. En effet certaines cultures (et ici je soulève une question quasiment métaphysique), comme la culture sumérienne ou la culture grecque, ont inventé ou accepté l’écriture en l’utilisant à des fins politico-administratives et aussi, disons, esthético-intellectuelles, alors que d’autres – je pense en particulier aux Mycéniens, ou aux Mayas de la période Classique – l’ont utilisée seulement dans le premier but; le second, pour lequel ils possédaient d’abondants matériaux, était confié à la transmission orale ou figurative-architectonique. Bref, on peut posséder l’écriture, sans nécessairement l’utiliser pour fixer une littérature.
Par rapport à cette problématique de l’usage, politique (dans la perspective du Pouvoir) et /ou littéraire, de l’écriture, Sciascia occupe une place originale, féconde, comme s’il dialoguait avec les auteurs cités plus haut, et fidèle à son optique d’intellectuel décentré, ou si l’on veut, hérétique. Le sujet est vaste et complexe. Je me bornerai à ouvrir une piste de recherche, en m’attardant sur l’objet qui a déclenché ma réflexion: la fin de cette intervention est en effet, chronologiquement, le début du chemin.
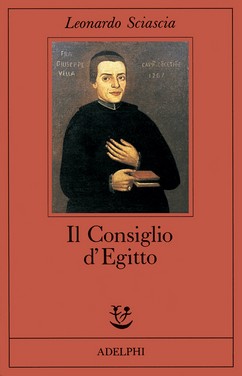 L’objet en question, vous l’avez compris, est Le conseil d’Egypte (Il Consiglio d’Egitto, 1963). Bref rappel de l’histoire, qui relate, interprète des événements réels, et devrait être bien connue (toutefois tous les détails mériteraient d’être analysés à la lumière de la perspective ouverte ici): nous sommes à Palerme, l’action commence quelques années avant la Révolution française, en 1782, et finit en 1795. Elle est centrée sur l’imposture de l’abbé Vella, auteur d’une contrefaçon-création (et aussi traduction) de deux faux codex arabes, qui raconteraient des moments importants des débuts de l’histoire sicilienne. Le premier, Le conseil de Sicile, résulte précisément d’un travail de contrefaçon réalisé à partir d’un objet réel, le codex dit de San Martino, dont on a mélangé les feuilles et altéré les lettres, pour créer de nouveaux caractères (bien sûr fictifs) « mauro-siculiens » ; à partir de cette corruption est inventée une traduction, qui raconte une improbable histoire de la Sicile musulmane (en fait, le codex de San Martino relate seulement une des nombreuses vies du Prophète en circulation…). Le conseil d’Egypte, plus ambitieux, est une pure invention pour laquelle Vella procède à l’inverse : il crée d’abord la « traduction » italienne, puis… la traduit dans l’original arabe, bien entendu son arabe à lui (la manière dont Sciascia considère l’opération de traduire mériterait une analyse à part). Ce nouveau codex approfondit le début de la période normande et en particulier redimensionne (s’il ne les annule pas) les droits de la noblesse, des Barons, qui vont chercher la légitimité de leurs propriétés dans cette lointaine époque. Et Vella fait le calcul que cela devrait lui attirer les sympathies et l’appui d’une monarchie désireuse de limiter les prétentions excessives de la noblesse ; toutefois, comme nous le savons, la vague anti-aristocratique est capable d’aller jusqu’à remettre en cause la monarchie elle-même. D’ailleurs, parallèlement, est racontée la conjuration de l’avocat Di Blasi, noble imprégné des idées des Lumières, qui aspire à l’instauration d’une République sicilienne et finira sur l’échafaud. (A noter que Di Blasi noue aussi ‒ ce n’est pas un hasard ‒ une sorte d’amitié avec l’abbé Vella.) En somme, avec en arrière-plan l’Europe bouleversée par la Révolution et la Sicile des Vice-rois (du réformateur raté Caracciolo, qui a connu les grands hommes des Lumières, parmi lesquels, justement, Rousseau, aux conservateurs immobilistes Caramanico et Lopez y Royo), le faussaire et le révolutionnaire se retrouvent d’une certaine manière alliés contre le pouvoir constitué.
L’objet en question, vous l’avez compris, est Le conseil d’Egypte (Il Consiglio d’Egitto, 1963). Bref rappel de l’histoire, qui relate, interprète des événements réels, et devrait être bien connue (toutefois tous les détails mériteraient d’être analysés à la lumière de la perspective ouverte ici): nous sommes à Palerme, l’action commence quelques années avant la Révolution française, en 1782, et finit en 1795. Elle est centrée sur l’imposture de l’abbé Vella, auteur d’une contrefaçon-création (et aussi traduction) de deux faux codex arabes, qui raconteraient des moments importants des débuts de l’histoire sicilienne. Le premier, Le conseil de Sicile, résulte précisément d’un travail de contrefaçon réalisé à partir d’un objet réel, le codex dit de San Martino, dont on a mélangé les feuilles et altéré les lettres, pour créer de nouveaux caractères (bien sûr fictifs) « mauro-siculiens » ; à partir de cette corruption est inventée une traduction, qui raconte une improbable histoire de la Sicile musulmane (en fait, le codex de San Martino relate seulement une des nombreuses vies du Prophète en circulation…). Le conseil d’Egypte, plus ambitieux, est une pure invention pour laquelle Vella procède à l’inverse : il crée d’abord la « traduction » italienne, puis… la traduit dans l’original arabe, bien entendu son arabe à lui (la manière dont Sciascia considère l’opération de traduire mériterait une analyse à part). Ce nouveau codex approfondit le début de la période normande et en particulier redimensionne (s’il ne les annule pas) les droits de la noblesse, des Barons, qui vont chercher la légitimité de leurs propriétés dans cette lointaine époque. Et Vella fait le calcul que cela devrait lui attirer les sympathies et l’appui d’une monarchie désireuse de limiter les prétentions excessives de la noblesse ; toutefois, comme nous le savons, la vague anti-aristocratique est capable d’aller jusqu’à remettre en cause la monarchie elle-même. D’ailleurs, parallèlement, est racontée la conjuration de l’avocat Di Blasi, noble imprégné des idées des Lumières, qui aspire à l’instauration d’une République sicilienne et finira sur l’échafaud. (A noter que Di Blasi noue aussi ‒ ce n’est pas un hasard ‒ une sorte d’amitié avec l’abbé Vella.) En somme, avec en arrière-plan l’Europe bouleversée par la Révolution et la Sicile des Vice-rois (du réformateur raté Caracciolo, qui a connu les grands hommes des Lumières, parmi lesquels, justement, Rousseau, aux conservateurs immobilistes Caramanico et Lopez y Royo), le faussaire et le révolutionnaire se retrouvent d’une certaine manière alliés contre le pouvoir constitué.
On sait comment la question du Pouvoir, avec sa violence mensongère, traverse toute l’œuvre de Sciascia et s’entrecroise avec celle de l’écriture comme possible antidote, instrument de lutte, de vérité… Mais voici que curieusement l’écriture même, sa fabrication, apparaissent par essence du côté du mensonge et du pouvoir. Rappelons à ce propos comment Lévi-Strauss ouvre la réflexion évoquée plus haut en observant l’imitation/invention par un chef Nambikwara d’une fausse écriture, incompréhensible pour tout autre que lui-même, qui s’en sert pour augmenter, voire refonder son pouvoir (Les Nambikwara sont justement une tribu sans écriture, de la forêt amazonienne). C’est une version simplifiée de la falsification opérée par Vella, qui utilise son invention pour fonder son propre pouvoir, c’est-à-dire les privilèges sociaux, la richesse et le prestige qu’il en retire; et pour l’un comme pour l’autre – exactement comme cela se produit dans le grand mouvement de l’Histoire – l’écriture, à l’instar de toutes les idées humaines, naît au contact, par imitation – et contrefaçon ! – d’autres idées, d’autres écritures… Bref, l’écriture, plus encore qu’instrument de pouvoir, serait elle-même Pouvoir.
Sciascia connaissait-il ces pages de Lévi-Strauss? C’est probable, même si le grand anthropologue français ne semble pas être sa source directe d’inspiration, ni faire partie de ses maîtres, de ses références, surtout si l’on pense que contrairement à lui Sciascia ne se réclame pas de Rousseau (sa référence, éventuellement, serait plutôt Diderot). Sciascia ne semble pas non plus particulièrement proche de Foucault, qui précisément dans ces années-là commence à élaborer sa théorie du pouvoir, avec l’idée que le savoir est en lui-même pouvoir. Il n’est pas non plus proche de Derrida, qui reprend, pour l’interroger, la question posée par la lignée Rousseau-Lévi-Strauss, renvoyant la violence de l’écriture au langage lui-même et procédant à une opération de « sauvetage », à une apologie de l’écriture parallèles en un certain sens à ce que fait Sciascia. Et pourtant, entre tous ces penseurs il y a une communauté de thématiques, de préoccupations, qu’on pourrait définir d’une manière générale comme post-modernes, plus précisément soucieuses de dévoiler la vraie nature de l’oppression dans la Société. Mais Sciascia conserve une distance tout à fait originale: depuis les marges de sa Sicile, dans son isolement, il élabore une réflexion sur les rapports entre pouvoir et écriture qui se nourrit de cette perspective caractéristique des années soixante et soixante-dix tout en s’en distinguant, gardant ainsi son caractère inclassable.
L’écriture (selon cette perspective) est, peut être violence, mensonge, instrument de pouvoir, pouvoir en elle-même: on retrouve des traces de cette idée bien sûr dans La mer couleur de vin (Il mare colore del vino, 1973), mais aussi dans Le jour de la chouette (Il giorno della civetta, 1961), puis dans Mort de l’Inquisiteur (Morte dell’Inquisitore, 1964), dans Noir sur Noir (Nero su nero, 1979) et plusieurs autres œuvres (je n’ai nommé que celles sur lesquelles je me suis attardé)… Mais c’est Le conseil d’Egypte qui fonde, au sens de Sciascia, la question, et en indique la solution, à travers une sorte de dramatisation narrative. Attention, je ne veux pas dire que cette interprétation du livre soit juste, ni qu’elle en épuise la richesse. C’est seulement une lecture possible, à la lumière des questions posées dans l’axe Platon-Rousseau- Lévi-Strauss sur l’écriture.
L’abbé Vella invente ainsi une écriture qui fonde son pouvoir, au sens précis où elle s’inscrit dans un rapport de pouvoir à la fois subtil et puissant : cette écriture diminuerait, voire anéantirait le pouvoir des Barons, augmenterait celui du Roi (mais aussi d’autres alternatives possibles, plus radicales, au système monarchico-aristocratique)… Toutefois, de même que l’alternative républicaine de Di Blasi s’effondre, l’imposture de l’abbé Vella s’effondre aussi. Tout est fini, alors? Non, parce que c’est Vella lui-même qui met fin à sa propre imposture, volontairement, et au moment précis où il a réussi à la faire passer comme vérité: en se dévoilant comme une imposture, du point de vue historico-politique, son écriture pourra en effet s’affirmer comme littérature. Telle se révèle être la véritable aspiration de l’abbé, plus que les privilèges et le pouvoir, comme il le raconte lui-même dans deux pages d’une extraordinaire puissance: «Seules les choses de l’imagination sont belles, et le souvenir aussi est imagination…» La littérature comme mensonge, donc, pour reprendre le titre du célèbre livre de Manganelli (La letteratura come menzogna, 1967)? C’est seulement une illusion d’optique, et rien n’est plus éloigné de la perspective de Sciascia. Non, c’est le Pouvoir qui est mensonge et violence, tout pouvoir, même les pouvoirs, certes préférables, qui se présentent in fieri contre un pouvoir explicitement totalitaire, comme la République de Di Blasi, ou indirectement celui que voudrait « aider » l’imposture de Vella.
Je rappelle la phrase citée en traduction plus haut, qui est – ce n’est pas un hasard – de Di Blasi : très souvent la vérité apparaît confuse, tandis que le mensonge prend l’apparence de la vérité. Mais la découverte que ce qui semblait vrai est faux, c’est-à-dire justement imposture, n’est que le premier renversement. (Et c’est, soit dit en passant, l’objectif explicite de l’œuvre, qui cherche à reconstruire la dynamique, le déroulement d’un fait historique marginal). Il y en a un second, plus important, et c’est le message souterrain de Sciascia, qui va au-delà du livre et fonde une poétique, alors que justement il étudie l’activité d’un faussaire: cette imposture, en se déclarant comme telle, se sépare définitivement du pouvoir et peut devenir finalement littérature, c’est-à-dire libre, et comme telle aspirer à la recherche de la vérité. Finta, si l’on veut (terme difficilement traduisible en français (à la fois feinte, fictive, artificielle, inventée…), non falsa, fausse.
Car, si le pouvoir, dans son implacable étroitesse d’esprit, est le véritable ennemi de la liberté de l’homme, il existe toujours, même à l’intérieur du pouvoir, des alternatives qui ouvrent des espaces de justice plus grands. C’est ce que suggère Sciascia, par exemple dans La Sicile comme métaphore (La Sicilia come metafora, 1979). La vérité à laquelle aspire Sciascia est alors celle rendue possible par l’écriture, qui cherche toujours à révéler les mensonges générés par le Pouvoir, sous toutes ses formes, et qui, tout en s’engageant dans toutes les luttes possibles pour la justice, ne se met jamais au service d’un parti, pour ne pas perdre son indépendance, sa liberté. Ce qui signifie, comme cela s’est produit avec la guerre d’Espagne, avec la mafia, avec l’affaire Moro, se retrouver dans la situation de critiquer des idées et des pratiques aussi dans le camp de ses amis, au point parfois de se faire des ennemis de ces derniers. Sciascia, en somme, n’a rien de l’intellectuel de parti – d’autres diraient organique, organico – même au sens noble de Calvino, et il est certainement plus proche d’un intellectuel dérangeant comme Pasolini, avec lequel les relations furent loin d’être simples.
Pour revenir au début de mon raisonnement, je voudrais rappeler que l’éventuelle perception négative de l’écriture, en Grèce comme dans d’autres traditions (je pense notamment à la tradition hébraïque), s’enrichit de l’idée selon laquelle le non-écrit… l’oralité serait infinie, et donc ontologiquement plus apte à exprimer le divin, l’extra-humain, l’absolu. Mais justement ces traditions nous enseignent aussi que le livre, bien davantage qu’un simple instrument ou qu’un prolongement des traditions orales, est lui-même plein d’une vertigineuse sainteté qui lui est propre et va au-delà du fait qu’il peut, comme on sait, être dicté par le dieu ou son messager. Le Midrash de la Genèse, par exemple, commente : Au commencement, Dieu lisait la Torah et créait le monde… C’est l’infini livre de Dieu – ou de la Nature – sur lequel Derrida a écrit des pages importantes. Du reste, la même méfiance formulée par Platon pourrait, plus que faire allusion à une forme supérieure d’enseignement non écrit, simplement vouloir fonder, défendre une écriture capable de rester infiniment ouverte, vivante: les Dialogues, justement, qui pour reprendre une célèbre image grecque sont, structurellement, l’expression parfaite de cette miraculeuse fusion de marbre et de parole ailée… D’ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler ici l’importance fondamentale de la lecture à voix haute (comme ces Dialogues de Platon qui devraient, selon l’ingénieur de La mer couleur de vin, être dits par Eduardo de Filippo…)
Sciascia, dans cette perspective complexe, plus proche de Montaigne ou de Borges que de Derrida, s’intéresse à l’écriture comme mémoire, dans sa dimension verticale. Car, comme le rappelle Borges, un livre est chargé de passé, et chaque fois que nous le lisons il a changé, la connotation des mots est différente. Et le Livre, comme le Don Quichotte admirablement analysé dans le chapitre IV de Heures d’Espagne (Ore di Spagna, 1988), où Sciascia, ce n’est pas un hasard, dialogue principalement avec le Maître argentin), se révèle être bien plus qu’un simple instrument : une véritable fin en soi, un objet infini.
Version française de Sophie Jankélévitch et Giuseppe A. Samonà








































