«Je ne suis pas voyageur, c’est un fait»: c’est sur cette déclaration que s’ouvre le Voyage en Italie. Giono est effectivement un casanier, un «voyageur immobile», comme il se désignait lui-même. Il se décide pourtant, en octobre 1951, à 56 ans, à partir vers le pays de son père et de son grand-père, territoire intérieur fécondé dès l’enfance par les récits paternels, les rencontres d’émigrés italiens à Manosque, puis par la lecture de Dante, de l’Arioste, de Machiavel, et de Stendhal, qu’il lit et relit avec passion.

Est-il besoin de dire que je ne suis pas venu ici
pour connaître l’Italie mais pour être heureux ?
J.G.
Si l’on voulait exprimer par une formule qui sans doute touche au plus juste la logique gouvernant la composition du Voyage en Italie de Jean Giono (1895-1970), on devrait songer au «principe d’indétermination» d’Heisenberg, selon lequel le comportement de l’objet observé est modifié par l’observateur. En effet, Giono sait tenir à distance la tentation présomptueuse – et ascétique – de vouloir saisir le réel simplement tel qu’il est, et, avec modestie, il nous avoue son plaisir pour «la vie quand elle est compliquée». «Je me suis efforcé de décrire le monde, non pas comme il est, mais comme il est quand je m’y ajoute, ce qui, évidemment, ne le simplifie pas. Je l’ai fait avec ce que je crois être de la prudence». Bien entendu, cette prudence n’est pas là pour garantir de l’exactitude de la description et du récit. Il s’agit d’une aptitude morale qui a à faire avec le respect de soi et de l’autre, car le monde que Giono côtoie et observe est celui – délicat et violent – des mœurs et des passions humaines.
Employé de banque dès l’âge de quinze ans, Giono se décrit au début du livre déjà comme un sédentaire qui a «pris goût au racinage» et a très peu voyagé. Néanmoins, l’obscur bureau d’employé à Manosque, sa ville natale, était déjà «une porte ouverte sur la vérité», une place assise pour «le spectacle constamment renouvelé des passions humaines les plus communes». Si Giono se révèle un observateur pénétrant de l’Italie et des italiens, c’est aussi grâce à cet exercice préalable d’un regard rétréci. Il y a une grande vérité dans ces aveux, et une sagesse que l’on retrouvera tout au long de ce livre délicieux. Sans aller loin, chacun peut être voyageur dans un bureau ou dans un jardin, la condition essentielle de l’expérience du voyage résidant moins dans le fait du déplacement que dans l’équilibre entre la tension et le relâchement d’un regard sensible et imaginatif. La meilleure préparation au voyage et à ses fruits, c’est peut-être d’apprendre d’abord à être voyageur chez soi, tout près de sa «forme de vie».
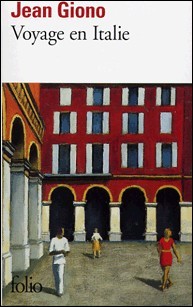
Voyage en Italie est composé de six récits qui portent sur le voyage entrepris à l’automne 1951 par l’écrivain, sa femme Elise et un couple d’amis, dans une 4 CV Renault décapotable qui les amènera à Turin, Milan, Brescia, Vérone, Vicence, Venise, Padoue, Bologne, etc. Loin du réalisme d’un globetrotter chroniqueur, ce qui prime dans ces récits c’est le regard créateur de l’écrivain, les effets subjectifs que le réel produit lorsqu’il rencontre son imagination. On a parlé de «réalisme subjectif» à juste titre, car Giono est fidèle et à ce qu’il observe et à ce qu’il comprend et ressent, sans rien exclure, sans considérer certains sujets plus importants que d’autres. Tout est important: l’ensemble et le détail, le vrai et le faux, le faits divers et la Grande Histoire, le prévu et le fortuit… Le livre abonde ainsi de micro-récits, de scènes de vie quotidienne où l’écrivain peut savourer et apprendre les multiples aspects du vivre italien. Allons voir de plus près.
La rencontre avec la machine à café, à Turin et à Brescia notamment, est une expérience où le savoir-faire technique d’une civilisation va de pair avec sa bravoure et son art de vivre, c’est-à-dire de jouir. La manipulation des manettes et des roues libère de puissants et dangereux jets d’eau et vapeurs, qui transforment la machine, tour à tour, en «alambic», «vieille locomotive» et «cheval de rodéo». Le garçon du bar, tel un «capitaine courageux», se charge de «donner au désordre un sens plus profond», en distillant de l’excellent café sous les regards subjugués des demoiselles. Tout d’un coup, un client entre et porte cette scène d’intérieur à son acmé: une fois le café dégusté, il claque sa langue contre son palais, signifiant à tous que c’est là que se trouve «la saveur exceptionnelle». C’est «une philosophie souriante» qui anime l’atmosphère de ce petit café de Corso Zanardelli à Brescia, et que Giono retrouve chez les Italiens qu’il rencontre. «A l’inverse des peuples du Nord, quand l’Italien est heureux, il le sait. Il lui faut aussitôt faire du prosélytisme…».
Cela dit, il ne faut pas croire que l’imagination de l’écrivain fasse disparaître la présence (lourde) du réel. Même si Giono est parti en Italie non pour connaître le pays «mais pour être heureux», les déceptions ne manquent pas. C’est ainsi que dans le petit port de Peschiera del Garda, l’allègre compagnie se voit servir une «exécrable friture». Comment est-il possible ? Un tour à la cuisine, une petite enquête sociologique, et l’énigme est résolue: ici comme ailleurs, la soif d’argent est en train de tuer la recherche du bonheur. Des considérations de ce genre se retrouvent de façon très occasionnelle dans le livre, mais Giono semble déjà entrevoir les dangers que court une civilisation si «savante en art de vivre» face aux idoles de la contemporanéité (l’argent et la vitesse notamment). Je songe tout naturellement à Pier Paolo Pasolini, et à ses réflexions sur la «mutazione antropologica» de l’Italie après la seconde guerre mondiale
[[Avec cette expression, Pasolini veut décrire le phénomène de destruction des particularités spirituelles, linguistiques et même physionomiques de la culture italienne, par le pouvoir uniformisant de la société de consommation (Cf. «Gli italiani non sono più quelli», Corriere della Sera, 10 giugno 1974, aujourd’hui dans Scritti Corsari)]].
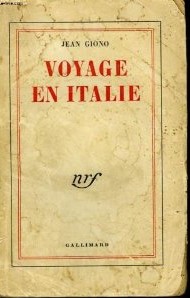
Mais ce qui m’a le plus touché dans ce livre vient du fait que Giono s’inscrit, d’une certaine manière, dans la tradition des moralistes français, que l’on peut faire commencer avec Montaigne (d’ailleurs cité une fois dans le Voyage). Cela n’a rien d’étonnant, car c’est en lisant des auteurs chers aux moralistes, tels Machiavel et Guichardin, que l’écrivain provençal s’est approché de l’Italie et de son anthropologie. Il a, comme tous ces illustres ancêtres, le goût du décryptage du cœur humain et de l’observation des expressions extérieures qui en signifient les mobiles cachés. Tout en sachant, bien sûr, que dans le champ des passions humaines, le rapport entre ce qui se montre et ce qui est n’a jamais une signification univoque et instituée une fois pour toutes. Si en Lombardie et dans le Piémont, l’apparence sert à devenir ce que l’on pense être, à Florence, elle sert à se cacher. Dans ce jeu de la manifestation et de la dissimulation, Giono voit un trait sublime du peuple italien. Un clin d’œil, un silence, un geste du corps, un mot poli ou impoli, répondent toujours à des exigences multiples. Vivre avec ces «gens passionnés» c’est faire œuvre d’un interminable exercice d’interprétation.
Le Voyage en Italie est un livre qu’il ne faut pas lire pour connaître l’Italie, mais pour écouter une petite leçon de philosophie jouisseuse que les Italiens – doués d’une «intelligence merveilleuse pour aller au bonheur» – rendent sans aucun doute plus propice, quand ils ne l’incarnent pas. «Vous n’imaginez pas comme tout est fait pour le plaisir. Il ne faut rien dédaigner. Le bonheur est une recherche. Il faut y employer l’expérience et son imagination. Rien ne paie de façon plus certaine».
Emiliano Ferrari
(publié en 2016)





































Jean Giono, Voyage en Italie.
bonjour
de jean giono, contemporain, allez savoir pourquoi on l’évoque si peu. Le livre « le hussard sur le toit’ est captivant, et pourtant aller à la rencontre de son oeuvre n’est pas si facile et j’ai été arrêté dans mon élan il y a quelques années par « un roi sans divertissement » et « colline », lectures âpres… et pourtant la langue n’est pas recherchée ni le récit alambiqué. Quelque chose de dérangeant et de déstabilisant même si rien a l ‘air d être fait pour justement pas, bien au contraire….. très étrange. Personnellement je suis venue à la lecture de jean giono via certains vieux films que j’ai vus dans mon enfance avec fernandel, et bien sûr mes 1ers livres ont été marcel pagnol, et évidemment, ce sont 2 regards de la provence et de la ruralité (c est ce qui est dit) complètement différents et c est pas ce biais là que plus tard jean giono m a intéressée mais je ne suis pas allée au bout. et en voulant revoir ses films en commençant par « cresus », je me suis arrêtée aussi net car c’est très âpre et étrange, …. car il ne donne pas de clés pour ma part, c est comme celà que je l’ai ressenti mais il imprime sa marque. je ne sais pas s’il y eu souvent des retrospectives de ses films d ailleurs.
Jean Giono, Voyage en Italie.
« Le hussard sur le toit » est captivant, c’est sûr. Personnellement, j’ai trouvé qu’il se lisait assez facilement. Les choses se sont compliquées quand je me suis penchée sur « Les âmes fortes ».Moi aussi j’ai ressenti quelque chose d’étrange et de déstabilisant , que je ne pensais pas trouver chez Giono. C’est vrai qu’il ne se donne pas de clefs. Il est même le premier à exprimer sa perplexité envers le personnage principal ! Si vous lisez ce livre, rendez-vous sur le site qui lui est consacré (www.lesâmesfortes…).Vous aurez peut-être des réponses à vos questions.
Jean Giono, Voyage en Italie.
Bonjour, J’ai adoré le voyage en Italie de Giono, même si mon préféré reste le voyage en Italie de Stendhal et plus près de nous, Le Promeneur Amoureux de Dominique Fernandez…ou même Porporino ou les Mystères de Naples… J’ai aimé l’Italie par les livres avant de la connaître… C’est à 19 ans que je suis venue pour la première fois en Italie. Le coup de foudre fut immédiat… De grammaire en canzonette et surtout le cinéma italien, j’ai appris l’italien… Comme j’aimais la cinémathèque du Palais de Chaillot qui programmait tout ce que le cinéma italien avait de meilleur… Et les petites salles inconfortables du Quartier Latin. Et puis, j’ai continué à lire l’Italie à travers Natalia Gunzburg et son ami Cesare Pavese, Primo Levi, Buzzatti et d’autres moins célèbres, j’aimais « i raconti » de celui qui a écrit « La ragazza di Bubbe », mais je n’arrive pas à me souvenir de son nom… Carlo Levi peut-être… Pour en revenir à Giono, comme Céline, il était plus ou moins à l’index. On le disait de droite… Mais absolument rien dans ses écrits le laisse présager, ce n’est pas comme Céline… Il n’en demeure par moins que l’originalité du style de Céline en fait un auteur majeur de notre pays… Mais voilà depuis l’après-guerre nous vivons dans le bien penser de gauche et nous sommes en train d’en crever… On peut avoir ses opinions politiques et reconnaître la valeur d’un auteur, d’un artiste… Or ce n’est pas le cas en France, il existe une forme de dictature littéraire… Il y a les auteurs qui pensent bien et ceux qui forcément pensent mal… Moi ça ne m’a pas empêché de lire Pavese et Céline ou Giono… à la file, pourtant pas vraiment du même bord… Ce qui compte c’est d’avoir quelque chose à dire et un mode de dire… Une écriture… Le reste on s’en moque…