Considérations sur l’actualité française, sur un livre, un film, et trois textes de théâtre italiens.
Depuis 2007, le pouvoir de la cinquième République, dont on a tant dénoncé la personnalisation, s’est pour ainsi dire brusquement incarné.
Cette incarnation est apparue comme un parfait contrepoint à l’indigence de la campagne présidentielle. Le second tour opposait une candidate socialiste peu capable de développer les sujets qu’elle avait choisi d’aborder et un candidat UMP s’affichant auprès de vieux chanteurs et d’un humoriste graveleux. Le débat était par ailleurs entaché d’un sexisme aussi ravageur qu’hypocrite. La première chef de l’Etat potentielle de toute l’histoire de France a été sans cesse mise en valeur pour son physique avantageux, à grand renforts de métaphores religieuses. Ses tenues immaculées, forcément virginales, incarnaient bien le pouvoir, mais chastement. Quant au petit homme nerveux qui occupe depuis son élection l’espace médiatique, un de ses premiers gestes a été de s’afficher en sportif impénitent -photographié en jogger en compagnie de plusieurs ministres. Dans sa première année d’exercice, il a divorcé puis s’est remarié avec une ex-mannequin à la réputation sulfureuse. La “mutation anthropologique” annoncée par Pier Paolo Pasolini aux Italiens dans ses Lettres luthériennes se réalise ainsi en France sous nos yeux, en l’espace de quelques années.
Comment s’étonner, que, jusqu’au 15 mai 2011, à un an des prochaines élections, le nouveau “favori des sondages” ait été un séducteur impénitent – et sans aucun doute plus célébré pour cette image que pour ses talents supposés dans la finance internationale? N’importe quel curieux pouvait découvrir sans peine que le terme de séducteur masquait probablement des penchants moins avouables, mais la pression médiatique, visiblement, avait choisi de s’exercer ailleurs.
Le lendemain de l’arrestation spectaculaire de l’ex-directeur du FMI, le Président de la République a fait annoncer sa propre future paternité: une première dans les faits, mais surtout dans les formes, un signe ostentatoire de jeunesse – rappelons que le président a 56 ans -, de fertilité, d’apaisement familial subtilement teinté d’Ancien Régime – le grand-père prenant la fonction très dynastique de l’annonceur officiel – après la supposée défaite de l’opposition dans la “bataille morale” . Avec cet “heureux événement”, l’incarnation du pouvoir a perdu son parfum de scandale, à l’instant même où son pendant inavouable, comme resté à l’état de fantasme – puisque l’accusé n’aura jamais été candidat déclaré – aura atteint un point de non retour, dans l’expression supposée d’un rapport de domination inique et bestial.
Cette omniprésence soudaine du corps dans la vie politique française rend à mon sens d’autant plus éclairante une interrogation sur le sujet dans le grand laboratoire cisalpin, ce que trois textes de théâtre, un film et un essai récemment traduit nous autorisent à faire. Nous pouvons grâce à eux en esquisser l’histoire, de l’Unité à nos jours.
Cette histoire, étonnamment, est d’abord une histoire de mort. Le corps obsédant de la civilisation chrétienne, faut-il le rappeler, est un corps sans vie, martyrisé qui plus est. Quiconque a vécu dans une atmosphère catholique l’a vu se multiplier sous ses yeux comme élément indispensable de tout décor humain. On mesure mal, il me semble, l’impact d’une telle image, dont enfant je ne manquais de m’étonner -pourquoi cette torture exhibée dans une salle de classe, un hôpital, un bureau ?

Dans Risorgimento POP, texte écrit par Marco Andreoli et Daniele Timpano à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de l’Unité italienne, c’est le corps momifié de Giuseppe Mazzini qui fait irruption sur scène. Ce n’est pas le corps du pouvoir, mais celui encombrant et sacré d’une république rêvée et non advenue, que ses adulateurs choisissent d’embaumer à sa mort en 1872, pour le montrer quelques temps au public.
Dans ce même texte teinté de provocation futuriste ou dada, un autre corps, réduit en poussières, fait apparition dans une petite boite. C’est celui du général Giuseppe Garibaldi, républicain rallié à la monarchie en 1860, pour donner vie quoi qu’il advienne à l’Unité du pays. Deux ans plus tard, ce même général est contraint par les troupes du nouveau royaume de mettre fin à ses penchants révolutionnaires. Cet épisode peu glorieux pour l’Italie naissante, où les chemises rouges se voient barrer la conquête de Rome par les troupes légalistes, sur le massif de l’Aspromonte, en Calabre, donne lieu à une chanson demeurée célèbre, reprise et parodiée par ailleurs dans le spectacle de Marco Andreoli et Daniele Timpano: E Garibaldi fu ferito, « Et Garibaldi fut blessé ». On remarque ainsi que, dans un texte explicitement sacrilège mais qui traduit assez bien, je pense, le regard actuel des Italiens sur la question, les deux véritables héros du Risorgimento en sont les deux perdants. “L’Italie est re-née puis elle est re-morte”, ironisent les auteurs à différentes reprises. Les vainqueurs, le politicien Cavour et le roi Victor-Emmanuel II, sont pour ainsi dire quasiment oubliés. L’image d’un Garibaldi blessé – avec ce glissement appuyé du physique au moral -a survécu dans le texte aux innombrables images du Héros des Deux-Mondes. Il a été pourtant l’homme le plus photographié de tout le dix-neuvième siècle, et sa popularité peut être comparée à celle obtenue un siècle plus tard par le Che.
Ce n’est pas la première fois que Daniele Timpano fait de la dépouille mortelle du pouvoir une sorte de personnage de théâtre. Dans Duce en boîte, sous-titré “Biographie post-mortem de Benito Mussolini”, il raconte les aventures rocambolesques du cadavre du dictateur, de l’exécution sommaire du 28 avril 1945 jusqu’à l’arrivée à la nécropole familiale à Predappio douze ans plus tard. On sait que les corps de Benito Mussolini, de Chiara Petacci, et de trois autres dignitaires du régime ont été pendus par les pieds et longuement exhibés à la foule Piazzale Loreto à Milan. Le corps du Duce a été vu par de si nombreuses personnes, dont le journaliste Indro Montanelli, qu’à la différence de son disciple autrichien, toute légende concernant sa possible survie en est devenue impossible.
Le nom du MSI, Mouvement Social Italien, fondé en 1945 dans la continuité du fascisme historique, a été interprété par certains, à défaut de pouvoir afficher clairement la référence, comme le sigle de Mussolini Sempre Immortale, “Mussolini toujours immortel”. C’est dire combien l’image du chef historique était encore présente, indissociable de l’idéologie qu’elle avait incarnée. Durant vingt ans, Benito Mussolini avait occupé physiquement l’imaginaire italien.
On se souvient de l’épouse malheureuse interprétée par Sofia Loren dans Une journée particulière (1977) d’Ettora Scola, montrant avec orgueil son album des photographies du Duce. Mais c’est sans doute avec Vincere (2009) de Marco Bellocchio que la violence prédatrice de cette omniprésence est apparue dans toute sa cruelle obscénité. À travers l’amour désespéré d’Ida Valser pour Benito Mussolini, on comprend combien ce dernier, qui a disparu de sa vie au cours de la première guerre mondiale, hante chaque lieu et chaque institution de son image, rendant tout oubli impossible. Jusqu’à la fin Mussolini a contrôlé son apparence, dont il aimait à souligner la virilité.
Aussi n’a-t-il jamais caché sa calvitie précoce – l’accentuant même afin de souligner la froideur martiale. Il a veillé en revanche à ce que sa taille modeste ne soit pas perceptible sur les photographies – c’était un des motifs qui l’amenaient à poser son veto sur certaines publications. Pour le reste, et ce trait ne manquera pas de surprendre si on le compare à l’attitude de nombreux autres dictateurs, Benito Mussolini aimait à poser torse nu, comme dans les célèbres photographies de propagande autour de la Bataille du blé, en 1925. Un rare équivalent contemporain serait sans doute Vladimir Poutine, photographié en voyage officiel pour Grozny en pilote de chasse, en pêcheur, le couteau à la ceinture, et encore tout récemment en motard. On sait qu’il a publié des calendriers à son effigie, où son physique vigoureux se change en objet de propagande.
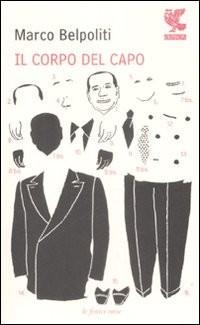
Après la guerre, l’homme d’état italien, nous explique en substance Marco Belpoliti, dans son essai “Le corps du chef”, ne pouvait plus s’incarner. La constitution de la République, en 1946, donnait au président une autorité essentiellement morale. Quant à l’action du gouvernement, à la manière des troisième et quatrième Républiques en France, elle pouvait être à chaque instant remise en cause par les chambres. Dans ce contexte, le corps du pouvoir était vu, en somme, comme une variante de sa personnification. Aussi n’est-il guère surprenant que la présence physique des grands leaders de l’immédiat après-guerre nous soit restée peu familière.
Il faut attendre le 9 mai 1978, et la découverte, en plein cœur de Rome, à mi-chemin des sièges de la Démocratie Chrétienne et du Parti communiste, du corps d’Aldo Moro, recroquevillé dans le coffre d’une Renault 4 rouge, pour que le “corps d’Etat” réapparaisse brutalement. Tel est d’ailleurs le titre donné par Marco Baliani à son récit théâtral de 1998, où il raconte l’affaire Aldo Moro au travers de ses souvenirs, cherchant à partager un vécu, celui d’un ex-étudiant gréviste et contestataire devenu comédien et travailleur social. Les vidéos et les photographies montrant le corps du président de la Démocratie chrétienne sont nombreuses, on y voit les autorités s’écarter afin de laisser voir la dépouille tragique, presque fœtale de celui qui, neuf semaines plus tôt, s’apprêtait à mettre en œuvre le compromis historique entre les deux plus grands partis de la péninsule.
Cet événement, par son caractère traumatique, a donné un brusque coup d’arrêt à ce qu’en Italie on a nommé le “mouvement”, c’est-à-dire la vaste mobilisation de la gauche extra-parlementaire pour une autre forme de vie politique. Il annonce le déclin inexorable de l’équilibre politique en place depuis l’après-guerre. La chute du mur de Berlin et l’opération “mains propres” transformeront cet effritement en cataclysme. Elles permettront surtout la percée spectaculaire de Forza Italia, et d’un nouveau type d’homme politique, en la personne de Silvio Berlusconi.

C’est sur ce dernier que porte l’essentiel de l’essai de Marco Belpoliti précédemment cité. Avec lui, nous explique-t-il, le “corps du chef” redevient le centre du pouvoir. Mais, son identité sexuelle joue de l’ambiguïté. Dans les années 1980 et 1990, comme l’a dit Jean Baudrillard, nous sommes “après l’orgie”. Cette stase idéologique succède à vingt années de luttes pour l’émancipation. Le corps postmoderne, annoncé dès la fin des années 1960 par la figure androgyne d’Andy Wahrol, est celui d’un homme se posant en objet de désir, ou bien celui d’une femme conquérante. En ce sens pourrait-on dire, Silvio Berlusconi est la réponse masculine à la froide Margaret Thatcher. Ce corps refait, qui se refuse à vieillir, multipliant implants et lifting, affichant au besoin la souffrance – ainsi de son visage tuméfié exhibé au public après sa supposée agression à Milan en décembre 2009 – est à la fois le prolongement et la négation du corps du Duce, dont il partage l’omniprésence médiatique. Avec lui, l’absence de programme s’incarne dans une enveloppe charnelle qui se voudrait imputrescible. Comme l’écrit Marco Belpoliti, ce corps est à l’image de cet “éternel éphémère” qui, depuis 1994, guide l’action politique de Silvio Berlusconi.
Olivier Favier








































