Les relations de trois des dix voyages en Italie du romancier René Bazin, élu membre de l’Académie française en 1903, paraissent sous forme d’articles dans le Journal des débats et dans la Revue des deux mondes, puis sont réunis dans trois recueils, édités par Calmann Lévy, A l’aventure. Croquis italiens de 1890, Sicile de 1892 et Les Italiens d’aujourd’hui de 1894. C’est dans un pays ennemi de la France que René Bazin se rend en 1889, en 1890 et en 1892, et le titre de son premier recueil le laisse clairement entendre, ainsi que l’avant-propos où il déclare son intention d’étudier la pénétration allemande dans la péninsule. En fait, l’écrivain est conquis par les Italiens et par l’Italie et ces voyages inspirent son œuvre romanesque, principalement consacrée aux travailleurs de la terre en France.

Bazin accorde une attention particulière à l’expédition coloniale italienne à Massaoua et il prend soin d’étudier les fortifications romaines en construction. Mais son troisième livre s’achève sur le souhait que l’amitié renaisse entre la France et l’Italie, dont les peuples n’ont jamais été vraiment divisés. A l’aventure s’ouvre sur la visite non d’une caserne, mais d’un domaine dans le nord de la péninsule car, dès ses premiers pas en Italie, chez René Bazin se révèle un vif intérêt pour cette terre «que le voyageur, d’ordinaire, se contente de regarder d’un œil distrait, par la portière du wagon, entre deux villes à musées» (A l’aventure, p.1). Les visites aux domaines et aux fermes se succèdent dans le Piémont, en Emilie, dans la Campagne romaine, en Calabre et en Sicile. Toujours, quelque intérêt concret guide le voyageur et le rend curieux de la paye des ouvriers, des impôts grevant la propriété, du rendement des vignobles et des mines de soufre, des récoltes de riz et de blé, d’oranges et de citrons. Bazin consacre un long chapitre aux problèmes de l’assainissement de l’Agro, la Campagne romaine infestée par la malaria.
Lorsqu’il cède au pittoresque, il reste très concret, ainsi dans sa description des charrettes peintes qui «en disent plus long sur le peuple de Sicile que vingt livres feuilletés» (Sicile, p.166), ou dans celle des chariots employés à transporter le vin des Castelli jusqu’à Rome, résonnant de toutes leurs clochettes. Il visite les étables des buffles qui acheminent, à travers les rues de Rome, les énormes blocs de marbre du monument à Victor-Emmanuel, et il remarque avec intérêt que chacun des deux mille buffles de l’Agro répond à un nom sonore et poétique.
Il accorde la plus grande attention aux cabanes des bergers, aux huttes des tâcherons et aux dortoirs des vachers. Il ne craint pas de consacrer un chapitre à la mafia, dans laquelle il reconnaît «une question de race et un état d’âme» et dont il espère qu’elle est vouée à la disparition, comme le brigandage (Sicile, pp.94,102). Il déplore, sans ambages, la pauvreté des ouvriers agricoles dans les fabriques de bergamote en Calabre et la misère de certains tâcherons, alors même que l’on se trouve à proximité du Vatican : «Nous sommes à quelques lieues de Rome, en pays de vieille civilisation, et voilà les huttes, dont aucun sauvage ne se contenterait, où vivent plus de trois cents personnes, hommes et femmes, neuf mois de l’année […]» (Les Italiens d’aujourd’hui, p.210).
Cette attirance pour la terre ne détourne pas René Bazin des villes italiennes. Il parcourt les plus petites comme Assise et Aci-Reale, et les moins connues comme Vigevano et Calatafimi, aussi bien que les villes moyennes, telles que Vicence, Padoue et Sienne, et les grandes cités, Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples, et en Sicile, Palerme, Catane, Messine, et même, au Nord, Trieste l’autrichienne. Aux sites touristiques, René Bazin préfère la visite du Lycée Visconti de Rome, des universités de Bologne et de Padoue – il enseigne lui-même le droit à l’université d’Angers –, de l’Institut pour aveugles de Milan, de l’Ecole industrielle de Vicence, de la Caserne d’infanterie de Bologne, du Tribunal de la Vicaria de Naples. Il goûte le pain du soldat dans une caserne, les figues de Barbarie en Sicile et la pizza à Naples à laquelle il trouve un goût «affreux» (Sicile, p.322). Il lit les petites annonces sentimentales, suit les processions et se mêle à la promenade du soir, «la grande flânerie de tout le monde» (Sicile, p.121).Il visite les cimetières dont le réalisme exacerbé le choque, prend le train en troisième classe et inlassablement, il interroge des fonctionnaires et des ingénieurs, des aristocrates et des paysans.
Des Italiens, critiqués par les voyageurs français de cette époque, René Bazin juge que ce sont des «travailleurs opiniâtres» et il écrit : «On ne peut pas séjourner, à plusieurs reprises, en Italie, sans être frappé, en effet, de la somme considérable de travail et d’intelligence qui s’y dépense, des projets de toute nature qui s’y agitent, de la valeur des hommes qu’on y rencontre» (Les Italiens d’aujourd’hui, pp.3,9). Les difficultés financières de l’Italie trouvent leur principale source dans les impôts excessifs frappant le sol à 33% du revenu net et les immeubles à 60% du revenu réel. En Sicile, les terres brûlées par l’éruption de l’Etna n’échappent pas au fisc. Le chômage est une grave plaie : à un concours pour soixante places d’employés au ministère des postes se présentent onze mille candidats «dont plus de deux cents munis de diplômes universitaires, et qui voudraient être facteurs !» (A l’aventure, p.272).
Les traits de caractère dont ses compatriotes font grief aux Italiens, René Bazin les analyse avec finesse : ainsi leur peu de goût pour les choses de la guerre, qui lui fait dire joliment, à propos des mères, des sœurs et des fiancées italiennes se lamentant du départ des soldats pour Massaoua : «Les Italiens sont tous un peu mères sur ce point» (A l’aventure, p.163). L’unité italienne datant de 1870, paraît encore très relative, du fait de la division entre le nord et le sud et du régionalisme extrêmement vivant dans tout le pays. Du costume seuls survivent le peigne en rayon des paysannes lombardes et la grande coiffe des Calabraises, mais la langue manifeste avec force le régionalisme. Un Florentin déclare : «Dans le grand monde et dans toutes les provinces, ici même, et à Rome, et à Naples, et à Palerme, quand on ne parle pas français, on parle patois» (Les Italiens d’aujourd’hui, p.99).
Le même phénomène se répète dans le domaine culturel, les Italiens lisant les romanciers français dans le texte, de Zola à Ponson du Terrail, tandis que leurs écrivains sont profondément ancrés dans leur région ou dans leur ville. Bazin cite bon nombre de romanciers et de poètes, en particulier dans le nord, le romancier Fogazzaro et la poétesse Ada Negri, en Toscane, Fucini, à Naples, la romancière Matilde Serao et le poète et narrateur en dialecte Salvatore Di Giacomo, pour la Sicile, Verga, et à Rome, le poète dialectal Belli, qu’il est un des premiers à évoquer en Europe. Bazin souligne la vigueur de ces dialectes : «C’est le peuple qui parle, qui rit et se moque, ou qui pleure» (Les Italiens d’aujourd’hui, p.73). De la culture populaire il observe les manifestations dans les spectacles des marionnettes et dans les récits des cantastorie de Sicile, remontant à l’antiquité et aux chansons de geste, et dans les représentations des théâtres des quartiers de Naples.
Ainsi René Bazin cherche à rencontrer le peuple des villes, comme les travailleurs de la terre, et de chacune de ces villes il cerne, dans les manifestations de la vie quotidienne, le sens profond : à Venise, c’est l’atmosphère propice à l’idylle, qu’il échafaude en romancier; à Trieste, c’est le caractère levantin, le partage entre Italiens, Allemands et Slaves, et la réalité de l’irrédentisme; à Bologne, c’est la ville docte avec son importante université et la cité prospère; à Rome, ce sont les catacombes et les églises, mais aussi les nouveaux quartiers, déjà en ruines du fait du krach immobilier; à Milan, outre le Dôme et le cimetière d’un réalisme surprenant, ce sont les nouvelles rues; à Naples, qu’il juge la ville la plus libre, la plus aimable et la plus généreuse de tout le pays, c’est l’éventration de la vieille cité, menaçant la civilisation du vicolo, la ruelle, véritable cellule de vie où se développent des phénomènes sociaux tels le lotto et la jettatura, la loterie et le mauvais œil, mais aussi un esprit d’entraide exceptionnel ; Palerme garde secret le luxe de ses palais, tandis que Catane et Messine sont florissantes.
A deux des villes de la Toscane, Florence et Sienne, Bazin consacre certaines de ses pages les plus inspirées. Il en donne une vision nocturne fantastique, concrétisée cependant, à Florence, par l’historique de la confrérie de la Miséricorde venant en aide aux malades et aux blessés et recevant pour récompense une mesure de poivre, dans la tradition des épices médiévales. De Florence, alors qu’il est au sommet de l’Etna, Bazin avoue : «Il n’y a pas de jour que je ne me souvienne d’elle» (Sicile, p.230). Il étudie le type florentin dans le public du théâtre de la Pergola, mais c’est en regardant la tête de Ghiberti, à la porte du Baptistère, qu’il éprouve un sentiment de fraternité et il évoque les artistes, ses contemporains, «qui liment leurs œuvres, comme lui sa porte de bronze, avec un long amour, parmi des villes troublées et des passions multiples» (A l’aventure, p.128).
Car René Bazin n’est pas seulement un observateur des mœurs, mais aussi un écrivain au style vibrant, admiré de François Mauriac. Dans nombre de ses pages se révèle son don de coloriste, ainsi à Venise : «Je regardais derrière moi les jaunes infiniment nuancés de la lagune sous cette averse d’or, et la bande violette du Lido bordant l’horizon» (A l’aventure, pp.37-38). Entre la Sicile et l’Etna, «le plus beau monstre qu’on puisse imaginer» (Sicile, p.74), c’est une lutte titanesque de lumière et d’ombre : lumineux Monreale, Segeste et la Chapelle Palatine de Palerme, opaques Nicolosi bâtie en pierre de lave et le volcan perdu dans les nuages et dans la brume.
C’est dans la Campagne romaine, espace «éveilleur d’infini comme le désert, l’océan ou la nuit..», que Bazin reçoit la révélation du rayonnement de la ville éternelle : «Notre voyage ressemblait à une ascension dans la lumière. Nous dominions un espace qui s’illimitait et qui renvoyait les rayons comme un miroir dépoli, sans fatiguer les yeux.» (L’Accueil de Rome, p.7 ; «Introduction au voyage d’Italie», L’Italie, Larousse,1897, p.13). A l’aventure se termine sur la visite de Bazin à un peintre français vivant à Rome, depuis quarante ans, symbole du rêve romain de l’écrivain. C’est ce peintre qui évoque la lumière spirituelle de la ville et invite Bazin à la goûter : «Si vous restiez ici, vos yeux deviendraient comme les nôtres, ils se déferaient de leurs brumes, ils se réjouiraient bientôt avec nous dans tout ce qui rappelle, attire, relance, répand la divine lumière où nous vivons…» (A l’aventure, pp.318-319).
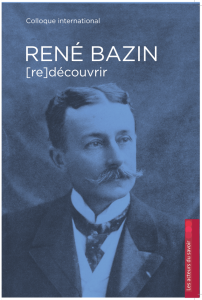
Ce personnage mérite les titres donnés par Bazin au grand artiste du XVème siècle, Fra Angelico, de «maître sans ombre» et au peintre Lojacono, rencontré en Sicile, de «voleur du soleil» (A l’aventure, p.304; Sicile, p.117). C’est ce Romain d’adoption qui fait saisir au romancier la beauté des marbres de Saint-Pierre, sur lesquels ruisselle la lumière, aussi René Bazin est-il un des très rares Français à apprécier le baroque italien, à la fin du XIXème siècle, bien que ce soit pour des raisons plus religieuses que strictement artistiques, car il n’en comprend la valeur que lors d’un pèlerinage. Bien que spiritualiste, il est fidèle à l’anticonformisme de ses itinéraires italiens, et il ne demande d’audience ni au pape ni au roi, contrairement à Zola et à bon nombre d’écrivains français, préférant encadrer le portrait de Léon XIII dans un pèlerinage d’ouvriers français au Vatican et celui d’Umberto dans la visite d’un Institut pour aveugles à Milan. De la part d’un écrivain parfois taxé de rétrograde, c’est une courageuse omission de la question romaine et de la suppression du pouvoir temporel du pape, qui indigne les conservateurs en France, à cette époque, et le souhait implicite d’une coexistence de l’Etat et de l’Eglise en Italie.
L’objectivité dont témoignent ces itinéraires de voyages de Bazin dans la péninsule, fort rare à cette époque, recueille l’approbation des contemporains aussi bien italiens que français, comme on le voit, entre autres recensions, dans les articles de la romancière napolitaine Matilde Serao. Dans les mêmes années, Rome de Zola se termine sur une vision funèbre de la ville et sur le présage de sa disparition, et Cosmopolis de Paul Bourget n’est guère plus optimiste. Bazin affirme, au contraire, sa confiance dans le destin de la jeune Italie. A d’autres romanciers français, des Goncourt à Zola, de Gide à Jules Romains, il abandonne les ténèbres de l’obscurantisme et les arcanes de l’espionnage à Rome, pour leur préférer la lumière. En 1908, cet écrivain spiritualiste affirme: «Le temps n’est pas à Rome couleur de cendre, il est couleur de flamme» (L’Accueil de Rome, p.8). Dans le langage pictural cher à René Bazin, c’est un acte de foi dans l’avenir lumineux de l’Italie.
Anne-Christine FAITROP-PORTA
Professeur honoraire des Universités
****
PS : (Sur René Bazin (1853-1932) s’est tenu à Angers, du 10 au 12 mars 2016, un colloque international, voir www.renebazin.org. Les Actes de ce colloque ont été publiés en mai 2017 (voir image de couverture dans l’article)
Ses livres sont disponibles sur le site de la Bibliothèque Nationale de France.)







































