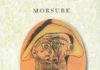Une “enfant terrible” italienne, entre mémoire et sensorialité. Installée en France depuis la fin des années 1980, c‘est en français que Gloria Paganini écrit son premier roman Là où je ne dois pas être. Un premier essai particulièrement maîtrisé et réussi dont la trame se déroule en Italie et dont nous parle l’italianiste Serena Vinci.
*****
KC éditions, maison fondée à Paris en 2023, vient de publier le premier roman de Gloria Paganini, enseignante-chercheure à l’Université de Nantes et directrice dans cette même ville du Festival annuel de cinéma italien. Née à Mantoue, diplômée en philosophie à l’université de Bologne puis en études italiennes à Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Gloria Paganini s’est installée en France à la fin des années 1980 et c’est en français qu’elle a choisi d’écrire son premier livre. La présence de son roman dans le catalogue de KC Éditions n’est pas fortuite : dirigée par Silvia Contarini, professeure de littérature italienne, la maison accorde une attention particulière aux synergies entre France et Italie : elle a ainsi publié un récit de jeunesse de Gian Pietro Lucini, Esprit rebelle, dans la traduction de Christophe Mileschi, et publiera bientôt le polar dystopique Tu auras mes yeux de Nicoletta Vallorani, traduit par Cristina Vignali.
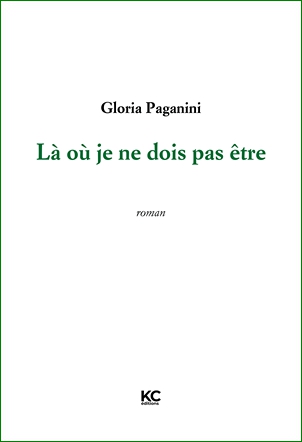 Là où je ne dois pas être de Gloria Paganini se situe dans le sillon de la littérature transculturelle et translingue, où se conjuguent ses deux pôles culturels de référence, l’Italie et la France. Il s’agit d’une puissante fresque narrative de la ruralité, qui frappe par ses sujets et son esthétique, mais aussi par l’impact qu’ont la langue et la culture françaises sur le récit. Je reviendrai sur ces deux aspects.
Là où je ne dois pas être de Gloria Paganini se situe dans le sillon de la littérature transculturelle et translingue, où se conjuguent ses deux pôles culturels de référence, l’Italie et la France. Il s’agit d’une puissante fresque narrative de la ruralité, qui frappe par ses sujets et son esthétique, mais aussi par l’impact qu’ont la langue et la culture françaises sur le récit. Je reviendrai sur ces deux aspects.
Ce titre intrigant est un reflet de la petite fille et représente sa façon de percevoir le monde qui l’entoure, c’est-à-dire d’un point de vue déplacé.
«La jeune mère est là. Elle pousse un souffle par les narines en serrant fort ses lèvres. Je suis là où je ne dois pas être. Mes oreilles sont chaudes, les mains glacées. Elle m’arrache la petite casserole, m’attrape par le bras. Je tente ma chance en éclatant en pleurs. Elle me tire de toute sa force. Elle crie ses mots de colère.»
Il met aussi le lecteur dans une position inconfortable, l’attirant immédiatement vers ce «Là» qu’il ne connaît pas encore, et qu’il va désormais explorer à travers le regard et l’expérience multisensorielle de la protagoniste, et grâce à la voix de la narratrice, qui ponctue le récit de son enfance, de quatre à sept ans. Le point de vue de cette fillette curieuse et turbulente, qui observe et en même temps défie son environnement, rappelle à certains égards celui de Modesta, l’héroïne de L’Art de la joie de Goliarda Sapienza, notamment dans sa manière de découvrir son corps et ses plaisirs, ainsi que dans la façon de gérer des émotions «inappropriées».
«Ses paroles me tachent comme du vin nouveau sur la nappe blanche. Livrée à cette voix qui m’humilie autant que j’afflige la jeune mère, le temps d’arriver à la maison et je suis une enfant malpropre. Je lève mon regard. Elle a les mêmes cheveux longs épais et noirs que la poupée en porcelaine, celle qu’elle assoit sur son lit à peine refait en déployant en éventail la robe de gitane à rayures colorées. Elle me semble vraiment maigre, quand elle me crie dessus et enserre ses yeux dans leurs fissures brunes.»
 La perspective tracée par la protagoniste nous fait comprendre comment les actions les plus ordinaires, les plus «normales» des adultes peuvent paraître énigmatiques ou démesurées, voire menaçantes, aux yeux d’un enfant. Cela s’applique aussi bien aux gestes déployés par les adultes qui l’entourent, et auxquels la fillette accorde une attention particulière, qu’à la vaste gamme de saveurs et d’odeurs qu’elle restitue, des moins appréciables – la vieille voisine qui sent l’ail – aux plus attrayantes :
La perspective tracée par la protagoniste nous fait comprendre comment les actions les plus ordinaires, les plus «normales» des adultes peuvent paraître énigmatiques ou démesurées, voire menaçantes, aux yeux d’un enfant. Cela s’applique aussi bien aux gestes déployés par les adultes qui l’entourent, et auxquels la fillette accorde une attention particulière, qu’à la vaste gamme de saveurs et d’odeurs qu’elle restitue, des moins appréciables – la vieille voisine qui sent l’ail – aux plus attrayantes :
«[…] tout près qu’elle est du festin elle doit bien la sentir, elle, l’odeur chaude de mamelle, d’auréole éclaboussée de gouttelettes de lait, d’iris sauvages gorgées d’eau dans les fossés, il frutto del seno tuo Maria. Je sens monter de je ne sais où une bulle d’arômes instables et sucrés que j’essaie de fixer en bloquant mon souffle, un goût de raisin-fraise se cherche en boucle dans mon estomac, parvient presque à se composer, mollit, se dissout aussitôt.»
Le récit se construit comme une série de fresques, de paysages vécus, dans un style qui prend parfois des reflets bucoliques, parfois des veines de néoréalisme : des éléments inquiétants, comme ces vieux paysans qui maltraitent les chats ou les poussins, le cafard dans la crème d’un gâteau, la façade d’un abattoir, le chien enragé, rendent grotesque, mais de ce fait encore plus fidèle à la réalité, une représentation qui pourrait sembler idyllique. Aux yeux de la petite fille tout est mélangé, beau et laid, bon et mauvais, haut et bas.
Le roman ne suit pas une intrigue traditionnelle, car ce qui importe est la découverte du monde et de ce qu’il contient, en commençant par les êtres humains, les membres de la famille, et en terminant par les animaux de la ferme. Du point de vue esthétique, la façon de raconter cette découverte de la beauté et de la laideur rappelle la rêverie du film Les merveilles (2014) d’Alice Rohrwacher, cinéaste et scénariste italienne. Pendant que la fillette découvre le monde, nous, lecteurs, découvrons avec elle comment elle est faite, petit à petit, à travers les similitudes qu’elle souligne entre ses proches et elle. Par exemple, une tante a les cheveux bouclés, comme elle ; mais surprise, cette tante est la plus laide des sœurs de son père, ce qui inverse le reflet positif, privilégiant les sentiments et les liens véritables.
Les images se superposent comme dans un rêve, fragments de mémoire d’où émergent des moments épiphaniques, comme le premier jour de catéchisme, ou des figures presque mythologiques, comme l’oncle communiste. Dans l’esprit d’un enfant, comme dans ses rêves, les noms propres n’ont pas beaucoup d’importance : on ne découvre le nom de la protagoniste qu’à la fin, dans un extrait tiré du journal intime du père. En fait, le roman est ponctué de digressions et de voix, comme si d’autres narrateurs s’introduisaient dans le récit, en s’imprimant dans un esprit perméable, celui d’une gamine en phase d’exploration et qui a soif de vivre.

Les aventures de cette «enfant terrible» se déroulent parallèlement à une menace fondamentale : le risque d’inondation du fleuve Pô. C’est comme si, tout au long de l’histoire, elle était elle-même à risque d’inondation, en raison de sa nature indomptable. La petite fille trébuche et tombe à plusieurs reprises, au sens figuré comme au sens propre. Le lecteur «trébuche» également, lorsqu’il rencontre des mots laissés en italien, qui évoquent un monde tantôt exotique, tantôt familier et peuvent donc provoquer un effet d’étrangeté ou de nostalgie (je me suis demandé d’ailleurs ce qu’il adviendrait de cet effet si le texte devait être traduit en italien). A mon sens, cette histoire racontée en français avec des accents italiens est parfaite telle quelle. Autrement, elle perdrait de sa saveur. D’autant plus que la narratrice se fait le porte-parole de questionnements sur la langue :
«Il n’y a pas de futur simple dans la langue de la maison. Il ne se conjugue comme tel que pour exprimer une supposition ou une hypothèse, relativement incertaines quant à leur réalisation.»
On peut songer à des réflexions générales sur le sens du langage, mais on touche également à une question plus intime, à une sensibilité qui caresse celle de Lessico Familiare de Natalia Ginzburg :
«Je, tu, il, elle. Dans la langue de la maison, comme dans celle qui m’a appris à écrire, et dans la suivante d’ailleurs, le pronom personnel détermine une unité dans sa singularité, connote un sujet dans son indivisibilité pleine et souveraine.
Dans ma première langue, contrairement à celles que je ferai miennes ensuite, il n’existe de ‘nous’ et ‘vous’ que dans la forme ‘nous autres, vous autres’. Nuàntar, vuàltar : le pluriel se déploie, nécessairement, dans un mariage des plus intimes entre deux opposés des plus irréductibles. Fusion aussi impérative qu’impérieuse. Destinée collective inscrite dans une fente vertigineuse. Acrobaties individuelles à cheval d’un suffixe, goût du même et de son contraire, si contraire il y a.»
Au final, lire Là où je ne dois pas être, c’est s’aventurer dans le regard d’une fillette et notamment dans les sensations d’émerveillement face au monde et à sa découverte. Mais, les mots pour le décrire sont ceux d’une écrivaine sage qui trouve la forme juste pour donner corps aux cinq sens constamment stimulés : le toucher, l’odorat, l’ouïe, vue, goût ; sans retenue, naviguant dans les eaux parfois tumultueuses qui mêlent la langue maternelle et la langue adoptée. Ou adoptante.
Serena Vinci
(Images © KC Editions)
LE LIVRE:
Là où je ne dois pas être
de Gloria Paganini
KC Éditions https://www.kceditions.fr/index.php/gloria-paganini/
174 pages, 18€, sorti en août 2025 (existe en format électronique)
NOTE DE L’EDITEUR:
Une fillette joyeuse et indocile, insouciante des interdictions et des ordres de sa mère, s’égare dans les sentiers sablonneux de la plaine du Pô, scrute la vie des grandes personnes avec leurs secrets, entraîne son petit frère dans des jeux dangereux, découvre la puissance des mots, s’amuse à dévaler les pentes à l’arrière du vélo de sa tante, partage avec sa famille l’angoisse de la crue : est-ce que la digue – l’argine – tiendra et leur maison sera-t-elle sauvée ? Dans une langue puissante, poétique et imagée, à travers le regard d’une gamine impatiente et solitaire, Gloria Paganini exalte la beauté et la dureté d’une ruralité pauvre, dans une Italie des années 1960, encore peu touchée par le miracle économique.