Alors que, le 8 mars, on célèbre les luttes des femmes pour leurs droits et leurs libertés, revenir sur certains personnages féminins de l’écrivaine sicilienne Maria Messina, dont les éditions Cambourakis ont récemment republié deux romans (La Maison dans l’impasse et Severa), nous rappelle à juste titre combien la société patriarcale, mais aussi des préjugés tenaces étaient synonymes d’oppression, d’enfermement physique et mental, pour la plupart d’entre elles.

Née à Palerme en 1887, Maria Messina publie son plus beau roman, La casa nel vicolo (La Maison dans l’impasse[1]) en 1920. Dans celui-ci, deux sœurs, Antonietta et Nicolina, dont la première est mariée à Don Lucio, vivent dans la même maison, au début en bonne entente. Issue d’une famille de la toute petite bourgeoisie, Antonietta n’a pas eu le choix : le mariage, même sans amour, avec cet homme aisé, est considéré comme une chance, pour sa famille et pour elle. Mais après la naissance de leur troisième enfant, don Lucio fait de Nicolina – qui, jusque-là, jouait le rôle de servante – sa maîtresse, et les deux sœurs sont obligées de cohabiter comme «deux ciseaux dans le même étui» : la première, blessée par la situation scabreuse que même les enfants perçoivent, la seconde revendiquant sa part de «bonheur», si on peut appeler ainsi ce ménage à trois imposé. L’aîné, Alessio, un enfant sensible, assoiffé de paix et de liberté, caresse le rêve impossible de réconcilier les sœurs devenues ennemies. En fait, c’est lui, l’innocent, qui paiera, victime de l’autoritarisme et de l’égoïsme paternel. Dès lors, les deux sœurs, unies dans la douleur, opposeront une résistance passive face à un don Lucio qui n’a plus de prise sur elles…
L’aîné, Alessio, un enfant sensible, assoiffé de paix et de liberté, caresse le rêve impossible de réconcilier les sœurs devenues ennemies. En fait, c’est lui, l’innocent, qui paiera, victime de l’autoritarisme et de l’égoïsme paternel. Dès lors, les deux sœurs, unies dans la douleur, opposeront une résistance passive face à un don Lucio qui n’a plus de prise sur elles…
Dans cette vie de recluses, quelques rares échappées apparaissent : coudre devant une fenêtre qui laisse entrevoir la vie extérieure et le ciel, se promener en ville et au bord de la mer lors d’un voyage d’affaires de don Lucio – mais ces deux dames mal fagotées font sourire les passants -, regarder avec Alessio de beaux livres qui leur laissent entrevoir un autre monde.

Tout le talent de Maria Messina consiste à savoir créer des atmosphères en peu de mots, à suggérer plus qu’à dire, à user de métaphores ou d’ellipses bien plus évocatrices que de longs discours. En cela, elle est plus proche de Tchékhov et de Katherine Mansfield que de Giovanni Verga, qu’elle considérait comme un maître et avec lequel elle a entretenu une longue correspondance.
Elle ne décrit qu’une seule dispute entre les deux sœurs, mais la violence feutrée de celle-ci est terrible, et l’image du matelas dont elles doivent battre la laine – «la housse rouge et blanche qui gisait dans un coin, comme un linge taché» -, symbolise la faute irréparable commise, et son évidence. Quant à leur «servitude», elle n’est pas seulement effective et consentie (Nicolina masse longuement le crâne de don Lucio, elle pèle ses fruits avec une patience infinie), elle est intégrée à leur vision de la vie: les femmes sont nées pour obéir et souffrir, l’homme, surtout quelqu’un comme don Lucio, est une sorte de guide spirituel même si à la fin, la tragédie qu’il a provoquée le fait tomber de son piédestal. Dans les dernières pages du livre, la boucle est bouclée : les deux filles d’Antonietta, adolescentes, regardent, rêveuses, la nuit étoilée. Ce qu’elles ignorent, c’est le destin qui les attend : «Elles grandissent comme certaines plantes bizarres et délicates qui apparaissent entre les lézardes des vieux murs, et que la pluie aura tôt fait d’abîmer.»
Sicilienne dans l’âme, et se revendiquant comme telle, Maria Messina a aussi vécu dans d’autres régions, au gré des affectations professionnelles de son père, inspecteur scolaire. Deux autres de ses romans, Un fiore che non fiorì[2] et L’amore negato (Severa dans la version française[3]) sont situés, le premier à Florence, puis en Sicile, le second à Ascoli Piceno, dans les Marches.
 Dans Un fiore che non fiorì, dont le titre pourrait laisser craindre un roman à l’eau de rose, apparaît l’une des héroïnes les plus inquiètes et les plus inquiétantes de l’œuvre de Maria Messina. Franca pourrait passer pour l’antithèse absolue d’Antonietta et de Nicolina : elle vit à Florence et son modernisme est étonnant. Elle porte, comme ses amies, des robes courtes et décolletées, se coiffe «à la garçonne», joue au tennis, fume, fréquente des lieux de spectacle et des salons en ville. Et elle a eu des flirts sans conséquence. C’est lors d’une soirée mondaine qu’elle fait la connaissance de Stefano, futur avocat, qui vit en Sicile et n’est à Florence que de passage. Des Siciliens, il a le caractère méfiant et ombrageux. Il est attiré par Franca, mais si l’ironie et la liberté de la jeune femme l’attirent, elles l’inquiètent aussi. Si bien qu’il s’en ira de Florence sans lui avoir fait la moindre promesse. Mais lorsque le père de Franca est nommé sous-préfet dans le village où vit Stefano, Franca n’hésite pas à quitter la Toscane pour découvrir, une fois sur place, un village hostile aux «étrangers». Espérant plaire à Stefano, elle laisse pousser ses cheveux, allonge ses jupes, s’adonne aux travaux d’aiguille… Rien n’y fera. Repoussée par celui-ci et par sa famille, elle rentre en Toscane où les signes d’une grave maladie se font de plus en plus patents. Parallèlement à cette dégradation physique, une impitoyable lucidité caractérise alors la jeune femme. Elle comprend que l’«honnêteté» de Stefano est «une vertu plus glaciale que la mort» et qu’il n’est qu’«un homme comme un autre, plus prudent et plus égoïste qu’un autre». Elle défend contre les bien-pensants une de ses amies qui a choisi l’amour au détriment des conventions et tourne en dérision «un bon mariage ? l’amour béni de Dieu, approuvé du maire, du curé et des gens ?». La vie entière lui apparaît comme dépourvue de sens, dans une sorte de nihilisme annoncé au début du livre, lorsqu’elle effeuille «machinalement une rose, au-dessus du clavier du piano semblable à une bouche moqueuse et édentée».
Dans Un fiore che non fiorì, dont le titre pourrait laisser craindre un roman à l’eau de rose, apparaît l’une des héroïnes les plus inquiètes et les plus inquiétantes de l’œuvre de Maria Messina. Franca pourrait passer pour l’antithèse absolue d’Antonietta et de Nicolina : elle vit à Florence et son modernisme est étonnant. Elle porte, comme ses amies, des robes courtes et décolletées, se coiffe «à la garçonne», joue au tennis, fume, fréquente des lieux de spectacle et des salons en ville. Et elle a eu des flirts sans conséquence. C’est lors d’une soirée mondaine qu’elle fait la connaissance de Stefano, futur avocat, qui vit en Sicile et n’est à Florence que de passage. Des Siciliens, il a le caractère méfiant et ombrageux. Il est attiré par Franca, mais si l’ironie et la liberté de la jeune femme l’attirent, elles l’inquiètent aussi. Si bien qu’il s’en ira de Florence sans lui avoir fait la moindre promesse. Mais lorsque le père de Franca est nommé sous-préfet dans le village où vit Stefano, Franca n’hésite pas à quitter la Toscane pour découvrir, une fois sur place, un village hostile aux «étrangers». Espérant plaire à Stefano, elle laisse pousser ses cheveux, allonge ses jupes, s’adonne aux travaux d’aiguille… Rien n’y fera. Repoussée par celui-ci et par sa famille, elle rentre en Toscane où les signes d’une grave maladie se font de plus en plus patents. Parallèlement à cette dégradation physique, une impitoyable lucidité caractérise alors la jeune femme. Elle comprend que l’«honnêteté» de Stefano est «une vertu plus glaciale que la mort» et qu’il n’est qu’«un homme comme un autre, plus prudent et plus égoïste qu’un autre». Elle défend contre les bien-pensants une de ses amies qui a choisi l’amour au détriment des conventions et tourne en dérision «un bon mariage ? l’amour béni de Dieu, approuvé du maire, du curé et des gens ?». La vie entière lui apparaît comme dépourvue de sens, dans une sorte de nihilisme annoncé au début du livre, lorsqu’elle effeuille «machinalement une rose, au-dessus du clavier du piano semblable à une bouche moqueuse et édentée».
On ne peut s’empêcher de penser à la terrible maladie qui, dès 1915, frappa Maria Messina: la sclérose en plaques qui la détruisit peu à peu, l’empêchant progressivement d’écrire, alors que les plus grands auteurs de l’époque reconnaissaient son talent.
 Son dernier roman, L’amore negato (Severa), publié en 1928, fut dicté à son infirmière, Vittoria. Situé à Ascoli Piceno dans les Marches, il met en scène deux sœurs, Miriam et Severa, l’une douce et soumise, l’autre ambitieuse et sans scrupules. Severa devient modiste et obtient de vifs succès auprès de la clientèle bourgeoise, dont elle voit clairement la mesquinerie et perçoit le mépris de classe. Mais elle tombe follement amoureuse d’un jeune homme qu’elle prend comme apprenti et qui la fuit lorsqu’il découvre ses sentiments pour lui. Elle sombre alors dans une dépression sans remède et se retrouve seule alors que sa sœur et sa mère vivent ensemble, dans une paisible routine… Un roman qui montre les ravages du désir et de la frustration dans un milieu provincial étriqué où les cancans et les fêtes de bienfaisance constituent les rares distractions.
Son dernier roman, L’amore negato (Severa), publié en 1928, fut dicté à son infirmière, Vittoria. Situé à Ascoli Piceno dans les Marches, il met en scène deux sœurs, Miriam et Severa, l’une douce et soumise, l’autre ambitieuse et sans scrupules. Severa devient modiste et obtient de vifs succès auprès de la clientèle bourgeoise, dont elle voit clairement la mesquinerie et perçoit le mépris de classe. Mais elle tombe follement amoureuse d’un jeune homme qu’elle prend comme apprenti et qui la fuit lorsqu’il découvre ses sentiments pour lui. Elle sombre alors dans une dépression sans remède et se retrouve seule alors que sa sœur et sa mère vivent ensemble, dans une paisible routine… Un roman qui montre les ravages du désir et de la frustration dans un milieu provincial étriqué où les cancans et les fêtes de bienfaisance constituent les rares distractions.
«Je veux être seule comme j’ai toujours été seule», écrivait Maria Messina dans sa dernière lettre, elle aussi dictée à Vittoria peu de temps avant sa mort, qui survint le 19 janvier 1944, près de Pistoia. En 1945, la maison où elle vivait fut bombardée. Ses souvenirs, ses archives, ses manuscrits et sans doute des inédits disparurent. Elle avait écrit des romans, de nombreux recueils de nouvelles et plusieurs livres pour enfants, tous publiés chez des éditeurs renommés. Il faudra attendre 1980 pour que Leonardo Sciascia la redécouvre et la fasse publier par Sellerio.
Je ne savais rien d’elle. Lectrice pour les éditions Actes Sud, j’ai été profondément frappée par La casa nel vicolo (La Maison dans l’impasse), au point que j’ai demandé à Hubert Nyssen, à l’époque directeur d’Actes Sud, si je pouvais le traduire. Ce n’était pas seulement ce que disait le texte qui me fascinait, mais aussi ce qu’il ne disait pas, et ses silences, et sa musique. L’absence de tout folklore. La justesse des dialogues. La violence rentrée et la terrible douceur des humbles. En me faisant confiance, Hubert Nyssen m’a fait naître à la traduction.
Marguerite Pozzoli
L’auteur:
Maria Messina est née à Palerme en 1887. La famille suit les incessants déplacements du père, inspecteur scolaire, d’abord à Messine, puis en Toscane, en Ombrie, dans les Marches et à Naples. Initiée à l’écriture par son frère Salvatore, qui avait perçu son talent, elle connaît la notoriété avec des recueils de nouvelles publiés alors qu’elle n’a qu’un peu plus de vingt ans. Elle jouit également de l’estime du grand Giovanni Verga avec lequel elle entretient une longue correspondance. Les années 20 seront celles de ses succès littéraires (romans, nouvelles, livres pour enfants), mais aussi de l’aggravation d’une terrible maladie qui, peu à peu, l’empêchera d’écrire. Elle meurt en 1944 à Pistoia, en Toscane, oubliée de tous. Ses récits, très appréciés de son vivant, ont été redécouverts par Leonardo Sciascia.
Les autres livres de Maria Messina publiés en France
Les recueils de nouvelles : La maison paternelle (1987) ; Petits remous (1988) ; La robe couleur café (1991) et Petites personnes suivi de Après l’hiver (2000). Tous ont été publiés aux éditions Actes Sud, et traduits par Marguerite Pozzoli.
A ces liens, tous les livres de Maria Messina publiés en italien par Sellerio editore Palermo ou par les edizioni Croce.
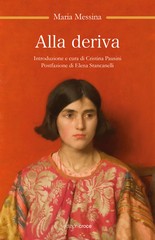

Un extrait de La maison dans l’impasse:
«Tout en travaillant dans le petit potager, derrière la murette chaude de soleil, en été, Antonietta pensait à don Lucio et essayait d’imaginer la maison où il habitait seul… Mais elle riait d’elle-même aussitôt, intérieurement, car il lui semblait stupide de laisser vagabonder son esprit autour de quelqu’un qui ne l’avait peut-être même pas remarquée. (…)
La petite Antonietta se trompait. Au cours de ses brèves et rares visites, don Lucio l’avait étudiée et observée. (…)
Nicolina était trop jeune. Caterina affirmait un caractère renfermé et orgueilleux ; ses manières un peu trop brusques et la façon qu’elle avait de vous regarder laissaient entrevoir une trop grande assurance et le désir de faire la loi.
Antonietta lui plaisait. Elle n’était pas belle, mais pas laide non plus. Ses yeux châtains étaient pleins de douceur. Sa robe sombre dessinait un corps déjà formé et bien fait. Ses mains, rêches et larges, ses poignets solides connaissaient la fatigue des travaux domestiques les plus humbles. Elle lui plaisait. C’était pour lui l’image même de la femme.»
[1] La Maison dans l’impasse, Actes Sud, 1986, traduit par Marguerite Pozzoli. Réédité par Cambourakis, 2020 en format poche https://www.cambourakis.com/tout/litterature/letteratura/la-maison-dans-limpasse/
[2] Un fiore che non fiorì, publié une première fois en 1923, puis par Edizioni Croce, 2017.
[3] Severa, Actes Sud, 1993, traduit par Marguerite Pozzoli. Réédité par Cambourakis, 2021, en format poche https://www.cambourakis.com/tout/litterature/letteratura/severa/





































Grazie, Margherita Pozzoli, che con la sua buona recensione, mi ha fatto conoscere una nostra Autrice, Maria Messina, che ben delinea, nel suo romanzo « La casa nel vicolo », la condizione della donna ai suoi tempi.
Un’Autrice da scoprire e da leggere.
Complimenti ancora e un cordiale saluto
Rosella Centanni
Ottima recensione. Complimenti.