Un véritable phénomène que cette jeune reine protestante qui, montée sur le trône de Suède à l’âge de 18 ans, abdiqua dix années plus tard, se convertit au catholicisme et vint s’installer à Rome, sous la protection du Pape. Une reine dont la présence fut vite considérée comme encombrante.
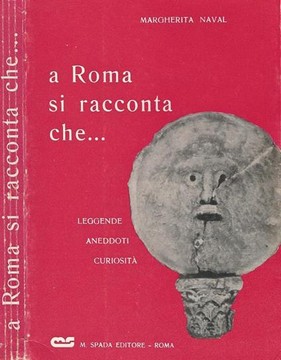
Diverses anecdotes sont liées à son séjour dans la cité papale, si bien que le délicieux recueil de Margherita Naval, A Roma si racconta che…, maintes fois republié depuis sa première édition, lui consacre une petite page (Aneddoti intorno a una regina), illustrée de la photo de la fontaine de la Villa Medici – la «fontana della palla di cannone» – une large vasque au centre de laquelle l’eau jaillit d’une boule de pierre censée être le boulet que Christine tira ou fit tirer sur la future Académie de France depuis le Château Saint-Ange.
La figure atypique de Christine de Suède n’a cessé de susciter hypothèses et curiosité. D’elle il a été dit «tout et son contraire». Aussi n’est-il pas inintéressant de parcourir deux récentes publications à son sujet : l’ouvrage, tout récemment édité, de Francesca De Caprio, «professore associato» de l’Università della Tuscia (Viterbe), et celui d’Anna Moretti, historienne française, sorti un an plus tôt. Alors que Francesca De Caprio centre son étude sur une période précise, l’arrivée de Christine à Rome et les somptueuses manifestations organisées en son honneur, Anna Moretti brosse une biographie d’ensemble et situe le voyage à Rome au sein d’un vaste contexte politique et historique. Enfin, comment résister au désir d’ajouter à ce parcours la patte théâtrale de Dario Fo (1926-2016) dont fut publié en 2017 par les éditions Guanda Quasi per caso una donna : Cristina di Svezia ?
*
Christine de Suède, d’Anna Moretti
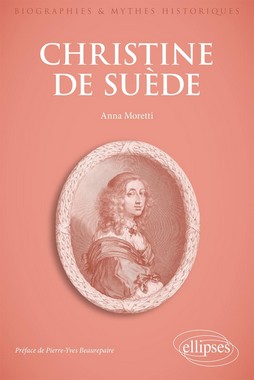
Le but de l’ouvrage d’Anna Moretti, Christine de Suède (Ellipses, 2022, 311 p.), est de montrer comment, alors que Madame de Sévigné la considérait comme «la princesse du monde la plus éclairée», cette reine résolument célibataire, jugée trop masculine, fut «portraiturée, caricaturée, dénaturée», au point de convaincre l’autrice de la nécessité de la «revisiter».
Fille unique du «Lion du Nord», le roi Gustave de Suède, souverain d’un puissant royaume allié à la France à qui il fournissait ses vaisseaux de guerre, Christine reçut dès son plus jeune âge une éducation virile. Elle n’avait que six ans quand son père fut tué à la bataille mais, la Suède ayant reconnu en 1604 que les filles de la dynastie Vasa étaient aptes à régner, un Conseil gouverna le pays jusqu’à sa majorité. Entre temps, elle reçut une éducation aussi remarquable que celle de la reine Élisabeth d’Angleterre, apprenant à parler couramment plusieurs langues, suivant des cours de philosophie et de mathématiques, se passionnant pour les arts et les lettres… Une véritable «femme savante», au sens le plus noble du terme.
Christine raconte dans ses Mémoires qu’elle fut instruite de tout ce qu’un jeune prince doit savoir et ne fut formée ni en homme ni en femme mais en monarque. La masse de connaissances qu’elle acquit, en ces temps où les femmes étaient considérées comme intellectuellement inférieures aux hommes, étonna, intrigua : d’où, quant à son sexe, un doute destiné à perdurer.
En 1654, à l’âge de 28 ans, se sentant prisonnière de l’État suédois et plus victime de sa naissance que privilégiée, elle abdiqua, afin de consacrer son temps à l’étude. Elle envisage d’abord une vie tranquille et dorée grâce à la pension viagère que la Suède s’est engagée à lui verser. Mais où vivre cette retraite ? Pourquoi pas à Naples ? Et pourquoi ne deviendrait-elle pas la nouvelle reine de Naples ? – l’échange de royaumes n’est pas rare, alors – car Naples, avec ses 400 mille habitants, est la plus grande ville de l’Europe chrétienne et son rayonnement est exceptionnel. Or, en 1647, le peuple napolitain, écrasé d’impôts et soutenu par la noblesse autochtone, s’est révolté contre Philippe IV d’Espagne et la noblesse ibérique, et il a appelé le roi de France à l’aide. Naples, avec son université prestigieuse, son vivier intellectuel, son passé culturel, ne pouvait que séduire Christine qui, en fait, rêvait moins d’une vie oisive que d’aller régner dans un cadre en harmonie avec ses aspirations.
Véritable coup de théâtre, l’abdication de Christine s’accompagne d’un coup de tonnerre, sa conversion au catholicisme, indispensable si elle veut régner sur un territoire catholique. En attendant, elle se fixera à Rome et se met en route vers l’Italie. Elle se convertit à Bruxelles, en présence de grands d’Espagne. Le pape Alexandre VII Chigi, qui vient de succéder à Innocent X, suit de près les événements et, en ces temps de Concile de Trente (1645-1663), entend exploiter cette conversion au profit du catholicisme. Il exige d’elle une abjuration publique, afin que soit montrée au monde entier la victoire du camp catholique.
La «deuxième conversion» a lieu à Innsbruck, à la fin de l’année 1655. Le pape fait de l’événement un instrument de propagande. D’Innsbruck à Rome les villes traversées organisent des fêtes somptueuses. Christine arrive à Rome le soir de Noël, pour une troisième cérémonie, la confirmation (la «cresima»), au cours de laquelle elle choisira d’ajouter à son prénom ceux de Marie et, en hommage au pape, d’Alexandra.

Logée au palais Farnese, elle suscite rapidement inquiétude et réprobation en raison de son comportement jugé trop libre voire grossier ; de plus l’argent promis par la Suède n’arrive pas, ou mal. C’est pourquoi le pape lui accorde l’autorisation de partir pour la France, où elle souhaite parler avec Mazarin de ses projets napolitains, acheter des armes et des uniformes afin de conduire ses troupes à Naples, et même agir en médiatrice de paix entre la France et l’Espagne : «Je suis de la troisième religion, celle de la philosophie», affirme-t-elle. En France elle est reçue avec les honneurs dus à son rang, rencontre Mazarin mais… à Fontainebleau elle fait mettre à mort son grand écuyer Giovanni Monaldeschi qui, affirme-t-elle, l’a trahie, informant Madrid de ses projets napolitains. Cette élimination ternit d’un coup son image : elle devient indésirable à la cour de Louis XIV. Mazarin rembourse ses dettes et demande au pape de lui pardonner afin qu’elle puisse regagner Rome. Quand elle quitte la France, son rêve napolitain est définitivement brisé, de même que son destin de médiatrice de paix, car bientôt Louis XIV épousera l’infante d’Espagne, scellant la fin de la guerre franco-espagnole.
À Rome, d’où elle ne partira quasiment plus, elle tombe en disgrâce. Mazarin est contraint de lui céder son propre palais, puis, à la mort de ce dernier, le cardinal Decio Azzolino, un ami de longue date, la loge dans le splendide palais Riario. Là, elle s’investit dans un rôle de femme de lettres, s’entourant de beaux esprits, créant l’«Accademia Reale», qui deviendra en 1674 l’Accademia Clementina, et dont les sessions seront régulières jusqu’à sa mort, en 1689.
Elle est l’une des très rares femmes à reposer dans la crypte de la Basilique Saint-Pierre.
Cristina di Svezia a Roma, de Francesca De Caprio

L’ouvrage de Francesca De Caprio, Cristina di Svezia a Roma. Il cantiere dell’immagine tra mito e storia (Città di Castello, LuoghInteriori, 2023, 272 p.), est centré sur les cérémonies organisées en l’honneur de l’arrivée de Christine à Rome et sur les problèmes en tous genres que cette venue suscita. Considérables furent, à cette occasion, les publications – lettres, satires, caricatures, opuscules – offrant des images très contrastées de la reine, mais l’autrice centre son étude sur les documents produits au sein de la Curie papale.
L’intérêt du livre est de permettre de mesurer à quel point le pape voulut construire une certaine image de la reine et utiliser sa venue tant au profit de son propre prestige que dans l’espoir d’une future Église réunifiée. La majeure partie des innombrables feuilles volantes destinées au grand public présentaient Christine comme une héroïne de la religion : cette reine avait renoncé au trône d’un des plus puissants royaumes d’Europe par amour de la foi catholique !!! Ainsi les poèmes sur le thème de son abdication donnent-ils naissance à un véritable mythe. Alors qu’elle avait gouverné un État guerrier et que la paix de Westphalie, qui avait mis fin à la Guerre de Trente Ans, avait été signée en grande partie grâce à elle, la propagande romaine amoindrit sa gloire militaire pour centrer l’opinion des lecteurs sur sa gloire morale et culturelle, et donc, par dérivation, offrir une image triomphante du pouvoir pontifical. Aussi était-il fondamental que soit mise en scène une profession de foi publique, assortie de maintes manifestations festives : riches cortèges dans toute la ville, décorations surabondantes, somptueux carrosses, costumes éclatants, feux d’artifice, fontaines de vin etc. – un luxe d’apparats dont le coût exorbitant ne manqua pas de susciter des réprobations.
Mais ce qui est tout aussi étonnant – et Francesca De Caprio a soin de s’y étendre – c’est l’obstination de Christine à vouloir organiser à sa façon son entrée à Rome et les modalités de ses entretiens avec le pape. D’entrée le protocole s’avérait compliqué, car l’accueil d’une reine célibataire était un fait inédit. Jusque-là, les souveraines en visite étaient des pèlerines ou des reines en exil, mais elles étaient épouses de rois. Or Christine se revendiquait reine sui iuris, de droit divin, et exigeait d’être reçue non comme une reine consort mais comme l’étaient les rois. D’où maintes négociations, par exemple, pour déterminer le type de siège sur lequel elle allait s’asseoir en présence du pape : les reines s’asseyaient sur un ou plusieurs coussins, les rois sur un tabouret pourvu d’un dossier, Christine refusa le coussin, si bien que Bernini lui-même dut fabriquer expressément pour elle un fauteuil pourvu de petits accoudoirs. Pour son entrée solennelle à Rome, le pape avait prévu à son attention un riche carrosse : elle le refusa et entra dans la ville à cheval, comme un roi, assise en amazone mais revêtue d’un manteau coupé de telle sorte qu’elle semblait enfourcher sa monture. En somme, quantité de détails inédits à régler impérativement avant les cérémonies ne pouvaient laisser augurer de relations faciles.
Bien vite, Christine fut pour le pape un sujet de préoccupations : non seulement son train de vie coûtait au Vatican une fortune, mais son comportement déplaisait: excessive familiarité avec les jeunes gens, moments de dévotion trop rares, peu de discussions sur des thèmes religieux, et une très haute considération d’elle-même. De plus son allure, jugée trop masculine, heurtait : une allure qu’elle-même cultivait par sa manière de se vêtir, de s’adresser aux autres, par son refus absolu du mariage, mais aussi par le mépris qu’elle affichait vis-à-vis de la gent féminine. Convaincue de la faiblesse physique, mentale et culturelle des femmes – «L’ignoranza delle donne, la debolezza della loro anima, dei loro corpi e del loro spirito le rendono incapaci di regnare», écrivit-elle dans ses Mémoires – elle s’attira l’inimitié des dames de l’aristocratie qui refusèrent de lui rendre visite. Un chroniqueur raconte qu’elle se souciait peu de converser avec les femmes « perché quando havesse discorso con loro del governo di qualche gallina, sarebbe compìto il discorso, o vero del modo d’imbellettarsi et ornarsi, di che essa è nemica capitalissima ». Sur les nombreux portraits d’elle qui nous sont parvenus ses vêtements de femme sont mêlés d’accessoires masculins, et elle eut à cœur de faire graver plus de cent médailles constituant une «storia metallica» de sa personne : elle est tantôt la «Minerve du Nord», promotrice du savoir, tantôt la Minerve guerrière, coiffée d’un casque et flanquée d’un rameau d’olivier, ou encore la Diane chasseresse : une reine virile, une femme détentrice de vertus qui sont d’ordinaire l’apanage des hommes.
L’analyse effectuée par Francesca De Caprio ne comporte pas d’allusions à une possible stratégie politique de la part de la reine. Or pourquoi tenir tant – et de façon si caricaturale – à ce titre de reine sui iuris (une précision inscrite dans son acte d’abdication), et pourquoi cette exhibition de qualités prétendument masculines sinon dans le but de gouverner un jour à nouveau… à Naples par exemple ?
Quasi per caso una donna : Cristina di Svezia, de Dario Fo
 C’est une tout autre image de Christine que brosse Dario Fo dans son ultime ouvrage, un «romanzo» dont le titre fait écho à une comédie créée en 1984 et déjà centrée sur une reine virile : Quasi per caso una donna : Elisabetta. Mais alors que cette pièce, ancrée dans l’actualité des années 1980, offrait de la reine Élisabeth Ière une caricature acide, dans Quasi per caso una donna : Cristina di Svezia l’auteur se montre plein d’empathie pour la souveraine, présentée dès l’introduction comme une «donna in tutto fuori del comune». Il ne s’agit plus d’une pièce de théâtre mais, s’agissant de Dario Fo, le théâtre ne peut manquer d’être fortement présent. C’est avec le point de vue de l’auteur-acteur-metteur en scène que se déroule le récit. Dario Fo “met Christine en scène” à l’aide de documents authentiques (textes historiques, chroniques d’époque, peintures, Mémoires), mais, ajoute-t-il, il l’a également «imaginée». Non seulement le roman est découpé en une série de courts chapitres, comme autant de petites scènes d’une même pièce, mais plusieurs de ces chapitres sont dialogués : non plus du «théâtre dans le théâtre» (un procédé cher à l’auteur) mais du «théâtre dans le roman» avec, dulcis in fundo, intervention de gens de théâtre.
C’est une tout autre image de Christine que brosse Dario Fo dans son ultime ouvrage, un «romanzo» dont le titre fait écho à une comédie créée en 1984 et déjà centrée sur une reine virile : Quasi per caso una donna : Elisabetta. Mais alors que cette pièce, ancrée dans l’actualité des années 1980, offrait de la reine Élisabeth Ière une caricature acide, dans Quasi per caso una donna : Cristina di Svezia l’auteur se montre plein d’empathie pour la souveraine, présentée dès l’introduction comme une «donna in tutto fuori del comune». Il ne s’agit plus d’une pièce de théâtre mais, s’agissant de Dario Fo, le théâtre ne peut manquer d’être fortement présent. C’est avec le point de vue de l’auteur-acteur-metteur en scène que se déroule le récit. Dario Fo “met Christine en scène” à l’aide de documents authentiques (textes historiques, chroniques d’époque, peintures, Mémoires), mais, ajoute-t-il, il l’a également «imaginée». Non seulement le roman est découpé en une série de courts chapitres, comme autant de petites scènes d’une même pièce, mais plusieurs de ces chapitres sont dialogués : non plus du «théâtre dans le théâtre» (un procédé cher à l’auteur) mais du «théâtre dans le roman» avec, dulcis in fundo, intervention de gens de théâtre.
«Bastian contrario» de toujours, champion notoire de la «contre-information», Dario Fo se déclare d’entrée en désaccord avec ce qui a été colporté sur la reine Christine. «Ma quante frottole su di lei !» s’exclame-t-il à propos de sa «masculinité». Il ne veut pas croire qu’elle ait été masculine parce que son père l’avait élevée comme un garçon ; ayant eu lui-même une formation de peintre, il affirme que les peintres qui l’ont représentée ne l’ont pas idéalisée et ont été «onesti e autentici riproduttori della stupenda donna che avevano di fronte». Oui, assurément, elle aimait les jolies filles, mais elle appréciait aussi les beaux jeunes gens. Enfin, il souligne la vaste culture de la jeune reine, dont la cour fut l’une des plus raffinées d’Europe, au point d’être surnommée «l’Athènes du Nord».
Ce que Dario Fo veut mettre en avant chez Christine, c’est son «senso acuto della libertà». Selon lui le véritable coup de théâtre que fut l’abdication «non fu follia […], ma coerenza». Elle ne voulait pas entendre parler de mariage parce que «non voleva cedere la propria indipendenza morale e umana a un uomo che si infila nel suo letto offrendogli così il diritto di ridurre a suddito la propria sposa». Elle voulait quitter la Suède où elle étouffait ; mais, pour ce faire, «doveva deporre la corona». «La libertà val bene la rinuncia a un regno!» écrit-il, pastichant le roi Henri IV de France. Dario Fo n’occulte pas son rêve de régner sur Naples ni la mise à mort du comte Monaldeschi, mais il ne s’y étend pas. Par contre il insiste sur le goût de la reine pour le théâtre, et là résident l’intérêt et l’originalité de son texte.
De toute évidence, lisant les mémoires et la correspondance de Christine, Dario Fo a pointé tout ce qui concernait le théâtre. Dès son jeune âge, écrit-il, «si era innamorata del teatro dei comici dell’arte, attraverso scritti procurati da studiosi di quel teatro che stava trionfando alla corte di Francia». La reine, affirme-t-il, invita à sa cour des troupes de comédiens, s’amusant avec intelligence quand les acteurs assaisonnaient les scènes d’allusions piquantes à sa propre personne. D’où, en 1658, le plaisir de rencontrer Molière à Rouen, d’assister avec enthousiasme à une représentation du Médecin volant et – imagine Dario Fo – des conversations avec lui, notamment sur la censure, «cruccio quotidiano» pour elle comme pour lui.
Ce qu’en revanche Dario Fo n’invente pas, c’est que Molière et Christine échangèrent des lettres quand la Cabale des dévots fit interdire le Tartuffe. Si on l’en croit – et pourquoi ne le croirions-nous pas ? – Christine en parla au pape, proposant de monter la comédie à Rome avec l’aide de la troupe de Tiberio Fiorilli, le célèbre Scaramouche dont Molière avait été l’élève à Paris. Bien sûr Louis XIV refusa de laisser Molière partir, et le Tartuffe fut représenté… avec le désastre que l’on sait. Molière, mortifié, prit sa revanche avec Dom Juan, où la critique de l’hypocrisie voilée de piété est encore plus virulente.
Christine la rebelle, l’excentrique, aidant Molière à faire accepter ses deux pièces les plus politiquement engagées, voici un pan inédit de l’action de la reine en faveur de la culture, et qui cadre à merveille avec le fait – authentique – que dans son palais du Riario elle fit installer un théâtre où furent joués des spectacles pour lesquels des femmes montèrent sur scène.
C’est sur la détermination de Christine en faveur de la défense des droits civiques que Dario Fo clôt son ouvrage : une Christine que, certes, il a forgée à son image, une Christine «de roman», mais une reine qui avait fait couler tellement d’encre et donné lieu à tant de ragots que cette plaidoirie en sa faveur anticipe un peu – avec l’argument théâtral en plus – la biographie que publia peu après Anna Moretti en France, soucieuse elle aussi de «revisiter» une femme «portraiturée, caricaturée, dénaturée» à l’excès.

Lors d’un prochain séjour à Rome, les lecteurs de ces lignes ne désireront-ils pas aller voir la «fontana della palla di cannone» ?, ou faire le tour des fontaines qui tant émerveillèrent la reine de Suède ?
Brigitte Urbani





































