Carlo Jansiti, auteur de “Violette Leduc, biographie”, Ed. Grasset, 1999, et de “La Correspondance 1945-1972 de Violette Leduc”, Gallimard, 2007, paru à l’occasion du centenaire de cette dernière (7 avril 1907), est italien mais a fait le choix d’écrire en français comme nombre d’auteurs étrangers. Pourquoi ? «Par souci d’osmose avec mon sujet, pour l’aimer dans sa langue à elle, par goût du défi. Du pari aussi»…
A l’occasion de la sortie, le 6 novembre, du film “Violette” de Martin Provost, consacré à la relation intense qui a lié Violette Leduc, l’auteur de “La Bâtarde”’, à Simone de Beauvoir, nous vous proposons à nouveau cet intéressant témoignage de l’écrivain Carlo Jansiti publié sur notre site en 2009. Nous signalons que “Violette Leduc, biographie” a été rééditée par Grasset en octobre 2013, avec un bandeau – image tirée d’une scène du film (Emmanuelle Devos).
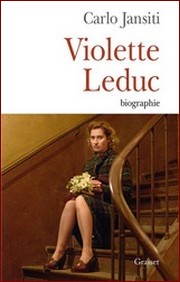
Ma première rencontre avec Violette Leduc eut lieu à Rome au début des années quatre-vingts. Alors que je flânais dans une librairie en quête de « Mort de la famille » de David Cooper (j’étais étudiant à l’Université de La Sapienza), mon regard se posa sur un livre placé sur une table. C’était l’édition de poche de « La Bastarda », dans l’admirable traduction de Valerio Riva, critique et éminence grise de l’éditeur Feltrinelli.
Ce titre qui illustre à merveille «la reprise d’un destin par une liberté» – j’appris plus tard qu’il avait été choisi par Simone de Beauvoir – attira d’emblée mon attention. Le regard perçant de l’auteur en couverture me plut aussi. J’ouvris le livre, j’en tombai amoureux dès les premières pages. Je fus séduit par la brièveté de la phrase mais plus encore par l’exactitude des mots, la liberté de ton, le foisonnement d’images baroques, de métaphores flamboyantes, de raccourcis inattendus, l’alliance de mots précieux à d’autres tirés de l’argot et plus «canailles».
À l’admiration pour ce style si original vint s’ajouter ma fascination pour certains thèmes que « La Bâtarde » abordait. Si les origines de Violette Leduc constituent, bien entendu, le noyau amer de ce livre, et de l’œuvre entière d’ailleurs, l’amour et la sexualité demeurent également au cœur de « La Bâtarde ». L’évocation de ses nuits avec Isabelle au collège, sa passion impossible pour Maurice Sachs, écrivain aventurier, dandy homosexuel, me marquèrent à jamais. Elles brisaient le silence, aéraient ma vie. J’étouffais dans la petite ville du Sud de l’Italie dont je suis originaire. Violette Leduc ne s’était pas trompée en déclarant lors d’un entretien : « Avec « La Bâtarde », j’essaie de déblayer, de libérer, il y a encore trop de préjugés à notre époque. Il faudrait que les femmes puissent parler aussi franchement que les hommes. Dans la vie, je suis très pudique. Mais dans mes livres je raconte tout. »

Tout comme Violette Leduc, j’avais connu, moi aussi, les amours condamnées et parfois des attraits sans issue. Genet, Pasolini, je les avais admirés sans m’y retrouver. Il demeure toujours une part de mystère dans la fascination pour un auteur. Dans le cas de Violette Leduc, j’aimais son audace, sa marginalité sociale et sexuelle, sa totale liberté dans la passion. Car elle pouvait aimer tout aussi bien une femme qu’un homme, homosexuel ou pas. Elle pouvait s’attacher à deux êtres à la fois, voire trois. Elle était ouverte au monde et absolument réfractaire à toute forme de sectarisme.
Un autre élément avait joué un rôle dans mon engouement pour cet écrivain. C’était ce que Violette Leduc appelle sa « laideur ». C’est surtout son « gros nez » qui la tourmente, ce « nez de demi-carème. » Je souffrais tout autant du mien. Une fois « La Bâtarde » terminée, je décidai de me faire opérer du nez, tout comme la Narratrice s’était fait opérer du sien. Ma vie changea du jour au lendemain.
D’autres scènes, également, m’avaient troublé, notamment celle où, en convalescence chez sa tante Laure, l’héroïne est traquée par des garçons à la sortie de l’école. Enfant, j’avais vécu une expérience analogue et je ne l’avais pas oubliée. Sans parler du sentiment de solitude, celui de me sentir un être à part, sans identité bien définie, qui avait accompagné toute mon adolescence. J’avais aussi, très tôt, été passionné de musique et avais étudié le piano pendant plusieurs années au Conservatoire de ma ville. Mon jeune professeur, élève d’Arturo Benedetti Michelangeli, m’avait vivement conseillé de quitter le lycée et de me consacrer entièrement à l’étude du piano. Il fallait choisir. J’hésitais. Une carrière de pianiste me séduisait mais, influencé par ma famille, je décidai finalement d’abandonner le Conservatoire. Violette Leduc elle-même, dans sa jeunesse, bien que dans un contexte très différent du mien, avait joué longtemps du piano et raconté dans son autobiographie comment elle avait dû renoncer à sa vocation de musicienne. Je me sentais donc en parfaite osmose avec cet auteur et presque happé par ses appels et ses offres (clin d’oeil à Rousseau) : « Le mois d’août aujourd’hui, lecteur, est une rosace de chaleur. Je te l’offre, je te la donne. » Violette Leduc devint dès lors mon double et la magie de ce transfert, cela va de soi, ne s’accomplit que par la force d’un style.
Certes, « mon cas n’est pas unique » et chaque admirateur s’est sans doute retrouvé en elle pour une raison ou pour une autre. Dans son essai, « Violette Leduc, éloge de la bâtarde » (Stock, 1994), René de Ceccatty a très justement analysé ce besoin immédiat d’identification.
 Je me procurai tous les textes de Violette Leduc traduits en italien. Mon admiration pour cette œuvre ne cessa de croître et je décidai d’apprendre le français pour l’aimer dans sa propre langue. C’est en français que je lus « La Chasse à l’amour », paru un an après sa mort. Le livre s’achevait à la veille de la publication de « La Bâtarde » : la maladie ne lui avait pas laissé le temps d’évoquer les années du succès ; j’étais resté sur ma faim. En 1985, j’écrivis à Simone de Beauvoir. Elle me répondit aussitôt: « Cher monsieur, je suis désolée mais le temps me manque pour des rencontres et puis je n’ai plus rien à dire sur V. Leduc. Avec toute ma sympathie. » Dans sa lettre, écrite de sa main, elle me renvoyait courtoisement à la relecture de ses Mémoires et me conseillait de me procurer « Les écrits de Simone de Beauvoir » par Claude Francis et Fernande Gontier (Gallimard, 1979).
Je me procurai tous les textes de Violette Leduc traduits en italien. Mon admiration pour cette œuvre ne cessa de croître et je décidai d’apprendre le français pour l’aimer dans sa propre langue. C’est en français que je lus « La Chasse à l’amour », paru un an après sa mort. Le livre s’achevait à la veille de la publication de « La Bâtarde » : la maladie ne lui avait pas laissé le temps d’évoquer les années du succès ; j’étais resté sur ma faim. En 1985, j’écrivis à Simone de Beauvoir. Elle me répondit aussitôt: « Cher monsieur, je suis désolée mais le temps me manque pour des rencontres et puis je n’ai plus rien à dire sur V. Leduc. Avec toute ma sympathie. » Dans sa lettre, écrite de sa main, elle me renvoyait courtoisement à la relecture de ses Mémoires et me conseillait de me procurer « Les écrits de Simone de Beauvoir » par Claude Francis et Fernande Gontier (Gallimard, 1979).
*****

Dans « Tout compte fait », en quelques pages, Simone de Beauvoir résumait les dernières années de la vie de Violette Leduc qu’elle avait découverte et soutenue jusqu’à sa mort. Dans l’un des passages du livre, je relevai le nom et l’adresse d’une amie de Violette Leduc : Madeleine Castaing, antiquaire rue Bonaparte. En août 1985, sur un coup de tête, je partis pour Paris pour lui rendre visite. Je rédigeais alors, pour un journal italien, des portraits d’artistes ou d’écrivains et j’espérais, témoignages à l’appui, pouvoir rendre hommage à Violette Leduc.
J’ignorais évidemment tout de cette Madeleine Castaing (1894-1992), « sponsor » de Soutine et célèbre décoratrice. Je doutais fort de la trouver encore en vie. Quelle ne fut pas ma surprise quand, en ouvrant la porte de son magasin, à l’angle des rues Jacob et Bonaparte (là où se trouve aujourd’hui la pâtisserie « Ladurée »), j’aperçus dans la pénombre d’une fin d’après-midi, enfouie au fond de ses meubles, dans un décor merveilleux, une dame de quatre-vingt-onze ans d’une étonnante jeunesse, insolemment maquillée. Assise dans son fauteuil, elle me souriait mais son regard était dur et noir. Un trait de crayon rouge redessinait sa bouche en coeur et des faux cils encadraient des yeux vifs et perçants comme je n’en avais jamais vus chez un être de cet âge. Un élastique passait sous le « tremblant » du cou, si serré qu’il paraissait couper sa gorge. Elle portait une perruque, des ballerines et des collants de danseuse. Elle me fit l’impression d’un personnage sorti d’un film de Fellini. Il Maestro, d’ailleurs, m’avoua-t-elle plus tard, avait voulu la faire tourner, en vain, dans « La Cité des femmes ».
Madeleine Castaing m’accueillit avec beaucoup de gentillesse et accepta aussitôt de me parler de Violette Leduc. Elle se leva de son fauteuil et, d’un signe de sa canne, recouvrant une insoupçonnable énergie, m’invita à monter le petit escalier en colimaçon qui menait à l’entresol au-dessus de la boutique, un endroit très cosy, plein de poésie et de charme. De très jolis meubles en acajou, des fauteuils anglais, des lampes en opaline, des bibelots originaux, des tissus aux couleurs vives, créaient une atmosphère à la fois singulière et intime. Sur un grand miroir, au-dessus de la cheminée, était écrit de biais le mot « Bellissima » d’un trait de rouge à lèvres. Elle me livra quelques confidences décousues sur la vie et la personnalité de Violette Leduc. Ma connaissance de la langue française étant très limitée à l’époque, cette première rencontre fut de courte durée. J’ai compris seulement, ou peu s’en faut, que la romancière s’était éteinte sans souffrir, qu’elle avait eu « une mort très douce. »
Madeleine Castaing était très liée à Jacques Guérin, industriel parfumeur et grand collectionneur de livres et de manuscrits. Il était l’homme que Violette Leduc avait passionnément aimé. Je le connaissais à travers son œuvre ; elle en avait fait un personnage si vivant qu’il m’était devenu familier. Dès mon retour en Italie, j’écrivis à Madeleine Castaing pour la remercier de son accueil et la priai de transmettre une lettre à Jacques Guérin. Accepterait-il de me parler de Violette Leduc ? Il me répondit. Une intense correspondance s’ensuivit. Une amitié naquit. J’avais également contacté deux autres amis de l’auteur, les écrivains Daniel Depland, qui avait été lancé par elle, et Monique Lange. Ils ne tardèrent pas, eux aussi, à se manifester. Un autre romancier se joignit bientôt au cercle d’amis et d’admirateurs : René de Ceccatty. Il avait publié un dossier sur elle dans la revue « Masques ». Cette chronique détaillée, très sensible et extrêmement fine, agrémentée de photos et de reproductions de lettres de Violette Leduc, m’avait enthousiasmé. J’ai correspondu également avec lui, et en italien, pendant de longs mois.
*****
Au printemps 1986, Jacques Guérin m’invita chez lui, à Luzarches, dans le Val-d’Oise, pour consulter les nombreux manuscrits et les centaines de lettres que Violette Leduc lui avait adressées pendant les dix-sept ans de leur amitié. Il possédait le manuscrit de « L’Affamée », les cahiers manuscrits de « Ravages » (concernant surtout l’histoire de Thérèse et Isabelle), de « Trésors à prendre », la version définitive des « Boutons dorés », sans compter les petits textes, comme « Je hais les dormeurs » ou la « Lettre à Blitz », publiés depuis dans les annexes de la biographie, et un certain nombre de photos, de livres (« la bible de sa jeunesse », par exemple) et de petits objets ayant appartenu à Violette Leduc. En véritable fétichiste, Jacques Guérin avait même gardé une pochette brodée par l’écrivain à son intention ainsi que la ceinture de sa « blouse de travail » à carreaux bleus et blancs. J’étais surpris de voir que les portraits de Violette Leduc trônaient dans sa maison. Elle y régnait en maître alors que dans l’œuvre, et dans la vie bien sûr, elle s’en était sentie si exclue.

Jacques Guérin avait à l’époque quatre-vingt-quatre ans et cinquante-six ans nous séparaient (il est mort en 2000 presque centenaire). Il avait été l’homme que Violette Leduc avait « le plus aimé ». Elle le décrit dans son oeuvre avec une étonnante justesse. Par son physique et son tempérament, il était très proche du « Jacques » de « La Folie en tête ». C’était tout à fait grisant pour le jeune Italien que j’étais de rencontrer en chair et en os l’un des modèles principaux de Violette Leduc. J’éprouvais le curieux sentiment de toucher là, presque du doigt, la Littérature.
Jacques Guérin impressionnait tout d’abord par son apparence. Il était grand, droit, avec un beau visage au front large et au regard bleu, à la fois perçant et flou derrière ses verres de myope. Rarement j’ai rencontré une personne de cet âge aussi débordante de santé, de vitalité, d’enthousiasme communicatifs. Doué d’une intelligence, d’une culture littéraire, d’un esprit critique hors du commun, et aussi d’une mémoire étonnante, il pouvait converser, ou plutôt monologuer, pendant huit heures de suite et dans un français admirable, comme on n’en parle plus aujourd’hui. C’était un homme du dix-huitième siècle né au début du vingtième. Son langage était incisif et suranné. C’était un conteur fabuleux. En l’écoutant, j’avais souvent l’impression d’être au théâtre. Il écrivait d’une façon tout aussi remarquable et j’ai souvent pensé qu’il était un écrivain virtuel. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il n’avait jamais songé à écrire. « Je ne sais pas ce que c’est que d’écrire, me répondit-il. Je ne prends pas part à la course. Je reste dans les tribunes. Je regarde. C’est tout. »
Ses goûts littéraires étaient vastes, éclectiques. Il avait été l’un des premiers admirateurs et amis de Genet – qui lui dédia « Querelle de Brest » et lui présenta Violette Leduc – à une époque où celui-ci était encore un auteur marginal. J’ai fait de longs séjours chez lui à la campagne. C’est avec lui que j’appris le français (j’avais décidé d’écrire ma biographie dans la même langue que celle de mon sujet). Il m’a aidé dans mon enquête en retrouvant parfois des adresses, des numéros de téléphone, en rédigeant des lettres de recommandation. Il a été un médiateur et un maître. C’est grâce à l’entremise de Jacques Guérin que la nièce de l’écrivain, Claude Dehous, voulut bien m’ouvrir ses archives.
Lors de mon séjour chez Jacques Guérin, l’idée me vint de rédiger un livre sur Violette Leduc. À cette époque cet écrivain était « une terre vierge. » En France, aucun essai ne lui avait été consacré, à l’exception d’une lecture psychanalytique de « L’Affamée » par Pier Girard. En dépit des efforts d’un cercle d’admirateurs fervents, on pourrait même dire de « fidèles », Violette Leduc traversait un long purgatoire. Elle était presque tombée dans l’oubli. Si on ne la confondait pas avec Viollet-le-Duc, ou Albertine Sarrazin, on la méconnaissait. Les éditeurs, les critiques littéraires rencontrés lors de mon enquête, à quelques exceptions près, la considéraient comme un auteur révolu. Elle était injustement sous-estimée et souvent, même, ignorée car la plupart de ces personnes ne l’avaient pas ou peu lue.
 « Pourquoi, lorsque je serai morte, aurait-on envie d’écrire ma biographie ? J’ai passé ma vie à ça. », avait confié Violette Leduc à une amie. Pourtant, c’était bel et bien ce pari que je désirais relever. La rédaction de mon livre fut à la fois un défi, l’apprentissage d’une langue et le tournant d’une vie. Je souhaitais redécouvrir cette existence que j’avais connue de l’intérieur. Car Violette Leduc est le perpétuel metteur en scène d’elle-même. Grâce à de simples faits oubliés, déformés ou occultés, aux variantes présentes dans ses manuscrits, aux correspondances croisées et inédites, aux témoignages, j’espérais pouvoir écrire une vie en contrepoint d’une œuvre. Les travestissements du réel, les « mensonges » disent aussi la vérité. Je voulais ressusciter cet auteur, la ramener de l’oubli à la vie. Car la démarche biographique peut éclairer d’une lumière nouvelle, souvent inattendue, une autobiographie aussi « sincère » soit-elle.
« Pourquoi, lorsque je serai morte, aurait-on envie d’écrire ma biographie ? J’ai passé ma vie à ça. », avait confié Violette Leduc à une amie. Pourtant, c’était bel et bien ce pari que je désirais relever. La rédaction de mon livre fut à la fois un défi, l’apprentissage d’une langue et le tournant d’une vie. Je souhaitais redécouvrir cette existence que j’avais connue de l’intérieur. Car Violette Leduc est le perpétuel metteur en scène d’elle-même. Grâce à de simples faits oubliés, déformés ou occultés, aux variantes présentes dans ses manuscrits, aux correspondances croisées et inédites, aux témoignages, j’espérais pouvoir écrire une vie en contrepoint d’une œuvre. Les travestissements du réel, les « mensonges » disent aussi la vérité. Je voulais ressusciter cet auteur, la ramener de l’oubli à la vie. Car la démarche biographique peut éclairer d’une lumière nouvelle, souvent inattendue, une autobiographie aussi « sincère » soit-elle.
Fidèle aux événements qui ont façonné sa vie, elle les plie pourtant à sa vision poétique du monde. Dans ses textes autobiographiques, Violette Leduc joue d’ailleurs sur l’ambiguïté du genre et est consciente des différentes formes littéraires englobées par l’autobiographie. L’écrivain elle-même avoue, lors d’un entretien, avoir eu recours, pour la rédaction de « La Bâtarde », à des « flots d’imagination » : « Je me suis souvent sauvée par des scènes romanesques. C’est pour cela que « La Bâtarde » n’est pas une vraie autobiographie. »
*****
De longues années durant, j’ai mené une enquête minutieuse en essayant d’éviter tous les pièges de l’excès d’empathie et, bien entendu, tout pléonasme. Je tiens ici à rendre hommage à la mère de l’écrivain, Berthe Leduc. Si par goût du secret elle brûlait les lettres qu’elle recevait de sa fille, elle confia tous les papiers, photos et manuscrits de Violette Leduc, dont elle avait hérité, à sa meilleure amie, une jeune voisine de Biarritz, qui les garda avec respect jusqu’à ce que la petite fille de Berthe eût l’âge d’en prendre soin. Sans ces précieux documents, il eût été impossible d’écrire une biographie suffisamment exhaustive.
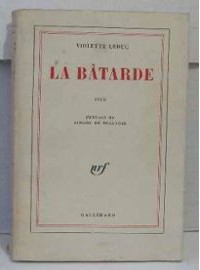
Lors de ma visite sur la côte basque, l’amie de Berthe Leduc me confia, avec l’accord de l’ayant droit, trois valises que je ramenai à Paris. Je les ouvris et je me mis à fouiller avec délectation, avec volupté même, dans ce véritable trésor. J’en sortis les cahiers manuscrits de « La Bâtarde », de « La Folie en tête », de « La Chasse à l’amour », plusieurs versions dactylographiées et corrigées de ces mêmes ouvrages, des cahiers de notes, des aide-mémoire, des épreuves, et un nombre impressionnant de photographies et de lettres reçues, toutes celles de Simone de Beauvoir que Violette Leduc avait amoureusement gardées prenant soin de les nouer avec un ruban noir, celles de Jacques Guérin, de sa mère, des Éditions Gallimard, de Jean Genet, de Nathalie Sarraute, de Colette Audry, du professeur de philosophie Yvon Belaval, de l’écrivain Thérèse Plantier, et encore celles d’admirateurs inconnus…
C’est en lisant ces lettres et ces manuscrits que j’ai pu découvrir le nom de famille d’Isabelle, le véritable nom de la femme qui inspira le personnage de Cécile dans « Ravages » et celui de Hermine dans « La Bâtarde ». Retrouver trace de ces personnes ne se révéla pas chose facile. Les convaincre de livrer leur témoignage encore moins. Leurs souvenirs étaient pourtant précieux car il s’agissait des amours de jeunesse de Violette Leduc. Des drames éclatèrent. Isabelle était morte mais j’avais obtenu l’adresse de ses enfants. Bien entendu, ils ignoraient tout de la liaison de leur mère avec Violette Leduc au collège de Douai. D’abord ravis qu’on s’intéresse à eux et tout à fait disponibles à communiquer des renseignements, ils changèrent brutalement d’avis après lecture de « La Bâtarde » et de « Thérèse et Isabelle ». L’un d’eux fit même une dépression, ce qui me troubla profondément, et menaça de m’intenter un procès si je citais dans mon livre le nom de famille d’Isabelle, leur mère. Denise Hertgès, en revanche, l’institutrice qui avait partagé la vie de Violette Leduc pendant neuf ans, était encore en vie. Après six mois d’enquête acharnée pour retrouver son adresse, elle refusa, à quatre-vingt-quatre ans, de livrer ses souvenirs déclarant qu’ « ils lui appartenaient et ne pouvaient intéresser personne. » En 1992 Denise Hertgès mourut. Sa nièce accepta alors de témoigner me confirmant en effet que sa tante avait voulu effacer totalement cet épisode de sa vie. Le nom de Violette Leduc était tabou. J’ai eu plus de chance, en revanche, avec la deuxième épouse de son mari, Jacques Mercier. Elle rassembla très volontiers ses souvenirs et m’adressa de longues lettres passionnantes restées en partie inédites. « Dans « La Folie en tête », m’écrivit-elle, Violette Leduc me désigne comme « la femme au turban », au visage ingrat et à l’air revêche. J’accepte le visage ingrat, ce qui est hélas le cas, mais refuse l’air revêche. »
Certains amis de Violette Leduc devinrent mes amis. Outre Madeleine Castaing et Jacques Guérin, je me liai d’amitié avec Françoise d’Eaubonne (j’ai voyagé avec elle en Bretagne et en Italie et je l’ai vue régulièrement jusqu’à sa mort), Daniel Depland qui me confia des extraits bouleversants de son journal, Thérèse Plantier qui m’invita à plusieurs reprises chez elle dans le Périgord, Michèle Causse, le peintre italien Paolo Vallorz, Mme Migneret, sa voisine de palier à Paris, Mme Morel, sa voisine de Faucon. Leur fréquentation assidue a été pour moi une source inépuisable de renseignements sur la vie de l’écrivain et parfois sur la genèse même de ses livres.
Ainsi cette œuvre, découverte au hasard d’une flânerie, a d’abord marqué mon identité culturelle et mon imaginaire, m’a incité à aimer et choisir une langue, qui, d’étrangère m’est devenue familière, puis a modifié, voire définitivement dévié, le cours de ma vie.
Carlo Jansiti

N.d.r.: Carlo Jansiti est également l’auteur de « Violette Leduc et Jacques Guérin : la tentation de l’impossible » dans l’anthologie « L’amour fou », 17 passions extraordinaires, Ed. Maren Sell, 2006.
Il a collaboré au film « Violette » de Martin Provost en tant que conseiller historique.









































Violette Leduc…Madeleine Castaing…A première vue tout semble les séparer !
Madeleine,issue d’un milieu bourgeois, gâtée par l’existence, Violette la « batarde »,qui a dû se battre pour exister!
Mais toutes les deux se retrouvent car elles sont des anti conventionnelles!
Madeleine Castaing, son talent d’antiquaire,qui a redonné ses lettres de noblesse au XIXeme siècle, à l’époque où la bourgeoisie ne jurait que par le 18ème siècle! Elle a su créer un véritable style auquel beaucoup de Decorateurs du monde entier se référent encore aujourd’hui ! Son univers est une véritable poésie, rempli de références à la littérature du 19eme siècle.
Violette dans son œuvre littéraire a voulu faire reconnaître la différence! En cela il y a déjà un point commun entre ces deux femmes, cette revendication du moi.
Ne pas se plier aux dictats, être toujours dans la revendication. Elles ne pouvaient que se retrouver quelque part,et leur amitié et leur respect et admiration mutuelle en sont la preuve. La personnalité, la passion, que ce soit pour l’écrit ou pour les arts décoratifs, ou tout simplement pour l’amour,voilà ce qu’il y a probablement de plus important,et qui liera les êtres à tout jamais !
Violette Leduc. Les coulisses d’une biographie, de Carlo Jansiti
Caro Carlo,
je viens d’engloutir, en 4 jours, La Bâtarde et La Folie en tête. Une découverte. Une claque. Un plongeon en apnée dans ce « besoin immédiat d’identification ».En fermant le second livre, je me disais justement qu’il serait impossible d’écrire une biographie de Violette Leduc, que tout ne serait que redite et redondance. Et pourtant, je découvre que vous avez osé relever ce défi à première vue insensé… Je ne sais pas si j’aurai un jour l’occasion de lire votre livre (je vis en Asie, trop loin des étagères de librairies francophones – seul Internet me permet aujourd’hui de me rapprocher de votre oeuvre). Mais je tenais tout juste à vous dire, humblement, CHAPEAU!