Lors de la Fête du livre et des cultures italiennes à l’Espace des Blancs Manteaux dans le Marais, nous sommes allées écouter et interviewer Melania G. Mazzucco qui présentait son dernier roman publié en France : « Un jour parfait » (Flammarion, 2009, traduit par Philippe di Meo) – « Un giorno perfetto » (Rizzoli, 2005). Roman foisonnant et brillant, c’est également un livre sombre qui évoque avec pudeur et sans manichéisme la société romaine actuelle en proie à la perte des valeurs traditionnelles. A lire absolument pour entrer dans l’âme de la Rome d’aujourd’hui.
Née en 1966 à Rome, Melania G. Mazzucco est un écrivain déjà confirmé : traduite en 22 langues, elle est l’auteur de six romans, dont le dernier né « La lunga attesa dell’angelo » (Rizzoli, 2008), une œuvre séduisante et riche sur Le Tintoret et Venise au 16e siècle n’est pas encore traduite en français.

« Un giorno perfetto », le titre du livre, dit l’auteur, renvoie à la célèbre chanson de Lou Reed, « Perfect day », liée à ses souvenirs d’adolescente, au mythe de l’underground américain. Elle chante la métropole, évoque un jour qui est tout sauf parfait, avant de se terminer par la phrase : « Tu vas recueillir ce que tu as semé », paroles qui, répétées à trois reprises à la fin de la chanson, sonnent comme une menace terrible.
Ce roman noir mais non dépourvu d’espoir, dit Melania Mazzucco, est l’histoire d’un crime, une tragédie contemporaine qui applique les trois règles du théâtre classique : unité de lieu (la ville de Rome), unité de temps (le 24 mai 2001, début de la décennie Berlusconi) et unité d’action (24 chapitres qui chacun représente une heure de cette journée fatidique, avec un prologue et un épilogue). En ouverture du roman, Rome s’endort, il est une heure du matin, cinq coups de feu, la police, sirène et gyrophare allumés, débarque dans un immeuble de la via Carlo Alberto près de Piazza Vittorio. Qu’est-il arrivé ? On ne sait pas. La particularité du roman est ainsi de nous laisser imaginer dès le prologue le drame final, faisant du récit un long compte à rebours où l’on va plonger dans le passé pour expliquer le présent, connaître au fil des pages les protagonistes du drame, raconter ce qui s’est passé pour qu’ils en arrivent là. Il n’y a, dit l’auteur, dans ce roman ni bons ni méchants, ni monstres, pas même l’assassin. Elle n’a voulu raconter que la complexité des êtres humains.

C’est un roman choral où se côtoient une dizaine de personnages issus de deux familles, les Buonocore et les Fioravanti, de milieu social différent, avec leurs émotions, leurs doutes, leurs préoccupations et espoirs. Tout au long du récit leurs histoires se croisent.
Antonio Buonocore, dit-elle, le principal protagoniste qui fait le lien entre ces deux familles, est un Italien très ordinaire, plutôt « macho », un homme qui représente l’ordre puisqu’il est policier et garde du corps d’un politicien, l’onorevole Fioravanti. Il respecte la loi, mais dans sa vie privée il n’y a que désordre et chaos. Sa femme, Emma, l’a quitté deux ans auparavant, emmenant avec elle leurs deux jeunes enfants, Valentina et Kevin. Antonio perd ainsi son rôle, son identité, sa raison d’être. Il se sent perdu et incapable d’accepter le choix et le désir d’autonomie d’Emma. Retrouver sa femme représente pour lui l’espérance de se retrouver soi-même. Comme sa femme ne reviendra pas, il n’aura de cesse de chercher à la punir et le drame final n’est autre que le châtiment qu’il veut lui infliger.
Quant à Emma, elle représente pour Melania Mazzucco la joie, le sourire, la vie et la douleur à la fois. Elle est à l’image de Rome, très belle, sur le corps de laquelle bien des choses ont passé, mais qui se relève, renaît sans cesse à la vie.
En écrivant cette fresque réaliste, c’est bien à Rome, figure centrale du roman, que l’auteur dit avoir voulu rendre hommage. Comme Lou Reed, elle a eu envie de « chanter sa ville », de la montrer sous un angle inattendu qui ne ressemble en rien à l’image touristique que donnent les cartes postales de la Ville Eternelle. Elle effectue ainsi un va-et-vient continu entre les quartiers de la périphérie et les beaux quartiers.
Contrairement à Pasolini qui décrivait les « borgate » romaines ou Moravia la Rome bourgeoise, « Un jour parfait » embrasse les diverses facettes de la ville, des call centers de la Tiburtina où travaille Emma à l’Esquilino où vit Antonio (quartier à forte présence africaine et asiatique) jusqu’aux palazzi chics et chers de Parioli où demeure la famille Fioravanti. Melania Mazzucco a cherché à restituer une ville réelle, palpitante, quotidienne. On y prend le métro, le bus, on en perçoit les bruits, le trafic, les odeurs. Ce n’est pas la photographie de la ville rêvée, mais Rome telle qu’elle est vécue par les Romains: une métropole du travail précaire, engagée dans l’économie, avec ses immigrés, ses différentes classes sociales, l’emprise de la télé du Grande Fratello, la ville du pouvoir où l’on suit la campagne électorale d’un politicien véreux, des écoles maternelles de la bourgeoisie, du racisme caché de la bonne société, des solitudes qui se côtoient… Etrange mélange en somme d’individus hétérogènes qui cherchent à s’identifier à une société sans cohérence ni valeurs.
NOTRE INTERVIEW DE MELANIA MAZZUCCO

La variété des registres linguistiques utilisés dans votre livre est très frappante, du babillage des enfants à l’argot des jeunes, du parler mondain des riches bourgeoises romaines à la langue de bois du politicien ou de l’administration.
M.M. – Oui, je m’étais lancée un défi, car pour moi c’était très important: caractériser chacun de mes personnages par sa façon de s’exprimer. Il y a dix personnages dans le roman, de 7 à 70 ans, issus de différents milieux culturels. Chacun a son histoire, et donc sa voix et sa musique. J’ai ainsi cherché à jouer avec les mots et « i modi di dire ». Les enfants, Camilla et Kevin, parlent différemment de Aris l’anarchiste, de son père le politicien, de Maya la Romaine bien élevée, de la jeune Valentina lorsqu’elle bavarde avec ses copains ou fait usage des codes des SMS. Dans l’écriture des dialogues j’ai voulu reproduire ces différents sons.
« Un giorno perfetto » a été adapté à l’écran par le réalisateur Ferzan Ozpeteck. Le film n’est pas sorti en France jusqu’ici, mais existe en DVD. Que pouvez-vous en dire ?
.
.

M.M.- Il y a toujours une grande différence entre le langage écrit qui suggère, créé des images mentales, et le langage cinématographique qui révèle, impose une vision.
Pour ce qui est du film d’Ozpeteck, j’ai choisi de ne pas collaborer au scénario bien qu’il me l’ait proposé. Le cinéma a besoin de liberté et le réalisateur doit pouvoir assumer sa responsabilité d’auteur.
J’ai préféré laisser Ozpeteck adopter mes personnages et les modifier selon sa sensibilité.
« Un giorno perfetto » est au final un film intimiste, alors que mon livre est un roman choral.
Le thème de la famille est récurrent dans vos romans, comme dans « Vita », « la Lunga attesa dell’angelo ».
M.M.- En effet, les mystères, les conflits au sein de la famille me fascinent. Chaque famille est un roman et je m’intéresse beaucoup à l’évolution de la famille italienne, bien plus complexe que le cliché qu’on en a. La famille est le microcosme d’une société en évolution, voire en révolution.
En Italie, depuis le début des années 2000, on constate une montée en puissance de la violence au sein de la cellule familiale qui avait pourtant déjà commencé auparavant à voler en éclats. Des mères, à l’instar d’une Médée, ou, comme dans Un jour parfait, des pères tuent leurs enfants, « tuant » ainsi le futur et l’espoir.
J’ai fait beaucoup de recherches pour mon dernier livre dans les archives vénitiennes du 16e. C’était impensable de tuer ses propres enfants à l’époque.
J’essaie donc de réfléchir à ce phénomène social pour en comprendre les raisons, savoir pourquoi cela se passe maintenant.
Selon vous, les faits divers de « chronique noire » sont-ils un indicateur des déviances de la société italienne actuelle ?
M.M.- En fait, mon projet dans « Un jour parfait » était de raconter un fait divers avant qu’il ne soit un fait divers publié dans les journaux ou annoncé à la télévision. Ce qui m’intéresse, c’est de reconstituer ce qui se passe avant le crime, au moment où tous les personnages sont « normaux », mènent une existence apparemment ordinaire. Il est toujours intéressant d’étudier l’histoire du crime, car les crimes nous parlent d’une société. Telle société produit tel crime.
Les faits divers dans les journaux, à la télé, semblent souvent nous détourner de l’essentiel, mais il ne faut pas les déprécier. Bien des écrivains, pour ne citer que Flaubert ou Dostoïevski, s’en sont emparés. Transfigurés par l’écriture, ils nous permettent de réélaborer l’Histoire et sont source d’une grande richesse.
Quel est le rôle de l’intellectuel dans l’Italie d’aujourd’hui ?
M.M.- C’est un moment difficile. Il y a actuellement une très violente campagne dans la presse de droite visant à discréditer les intellectuels et la culture en général. Elle s’accompagne d’insultes touchant parfois à la vie privée. En tant qu’individu, l’intellectuel compte peu, il n’est pas important sur le plan social. Par contre, les livres durent plus que les insultes.
Dans des moments comme celui-ci, l’intellectuel, l’écrivain doit donc observer avec attention ce qui se passe et être incité à écrire.
Les livres doivent divertir, faire réfléchir, mais au-delà de cela, ils laissent une trace de ce que nous avons été, de la façon dont nous avons regardé le monde, cherché à le comprendre, sans toutefois prétendre le changer.
Laurence Badot et Evolena
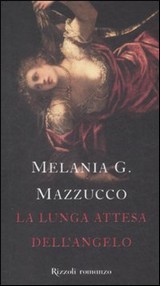
Pour en savoir plus sur « La lunga attesa dell’angelo »












































