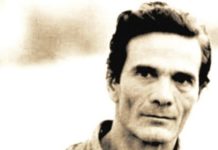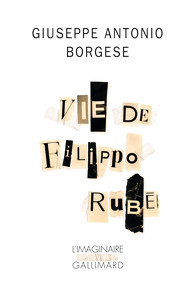
En republiant tout récemment dans la collection L’Imaginaire une nouvelle traduction de Vie de Filippo Rubè de l’auteur sicilien Giuseppe Antonio Borgese, traduit de l’italien, préfacé et annoté par Muriel Gallot, les éditions Gallimard donnent en quelque sorte à l’œuvre, précédemment parue en 1995 chez L’Arpenteur [[La première publication en français, incomplète, avait vu le jour aux éditions Plon en 1928 dans la traduction de Marthe-Yvonne Lenoir.]], le statut d’un classique que l’Italie ne lui a peut-être pas encore vraiment attribué.
L’écrivain sicilien (1882-1954) eut d’abord la renommée d’un critique subtil et d’un brillant professeur. De 1904 à 1906, il dirigea la revue Hermes, collabora au Corriere della Sera et à La Stampa, et il enseigna la littérature allemande à Turin et à Rome, puis l’esthétique à l’université de Milan (germaniste de renom, il épousa en second mariage aux Etats-Unis, la fille de Thomas Mann, Élisabeth). Publié en 1921, le roman fut par la suite réédité en 1946, à une époque où s’épanouissait le néo-réalisme. Les caractéristiques néoréalistes ne correspondaient guère plus au style du livre, mais s’y dessinait le malaise de la société et des intellectuels dans la période préfasciste. Ainsi, Mario Isnenghi reconnaissait une grande intelligence d’observation à Borgese dans Il mito della grande guerra da Marinetti a Malaparte, publié en 1970 aux éditions Laterza. Le séjour universitaire de l’auteur aux États-Unis en 1931, que le refus de prêter serment au régime fasciste (confirmé par une lettre à Mussolini en 1933) rendit définitif, le tint éloigné de l’Italie jusqu’à son retour en 1949. Cet éloignement volontaire permit notamment à Borgese d’écrire Goliath, the March of Fascism (1937), qui ne fut traduit en italien qu’en 1946 [[G. A. Borgese, Golia, marcia del fascismo, trad. Doletta Caprin Oxilia, Milan, Mondadori, 1949 [1946].]], où l’observation lucide du processus historique des années de mise en place du régime fait pendant à celle d’Emilio Lussu dans La marcia su Roma e dintorni (publié en 1932 à Paris).

Ce qui dérouta dans Rubè, ce fut notamment le fait qu’il s’agissait aussi d’un roman d’amour et de mort à l’écriture ardente, peuplé de femmes et de paysages, en quelque sorte inclassable. Le livre met en scène l’avocat Filippo Rubè, un fils de la petite bourgeoisie italienne qui, à l’issue de la Première Guerre mondiale, livre sa rancœur dans un monologue intérieur où se reflète le discours de sa classe sociale. Dans les rapports du protagoniste à la société avec laquelle il reprend contact au sortir des tranchées, on perçoit comment le ressentiment de la bourgeoisie et des petits propriétaires italiens de l’époque a pu très vite profiter à l’avènement du fascisme dans l’immédiat après-guerre.
Le livre eut en Italie un accueil contrasté, principalement en raison de son style flamboyant; mais Guido Piovene (qui fut l’un des élèves de Borgese à l’université Ambrosiana de Milan) y reconnut un roman « […] qui représentait pour la première fois la crise de l’intellectuel moderne ». L’auteur fut en effet un antifasciste virulent d’inspiration libérale-risorgimentale (même si son point de vue différait de celui de Benedetto Croce, le théoricien libéral et antifasciste italien le plus en vue dans l’époque de l’entre-deux-guerres) et il a fait partie de la petite constellation des intellectuels italiens qui s’opposèrent au régime (qui avait été instauré à partir de l’automne 1922 en Italie). Par ailleurs, c’est à Borgese que l’on doit – comme une preuve de sa lucidité quant au climat artistique de son époque – le qualificatif de «crépusculaires» pour désigner un groupe de jeunes écrivains italiens contemporains qui n’avaient « […] qu’une émotion à chanter: la trouble et limoneuse mélancolie de n’avoir rien à dire ni à faire»[[Norbert Jonard, «Crépusculaires», Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 14 février 2015 [URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-crepusculaires/].]].
Ainsi, au début du chapitre XIII (nous sommes à Milan, à la «mi-décembre, peu après minuit»), l’environnement du protagoniste, rentré de Paris où il a passé sa convalescence après une blessure sur le front du Carso en 1917, s’impose dans son hostilité («les silhouettes des voyageurs, au bas de la volée de marches, se dissolvaient dans un lac de ténèbres translucides»). L’errance de celui qui apparaît d’emblée comme un anti-héros, à travers les avenues vides de Milan en quête d’une chambre d’hôtel, accompagné d’un portefaix, le campe d’emblée dans son sentiment de désorientation (il a finalement l’impression de ne pas avoir quitté Paris, les «kiosques brillants des grands boulevards» et les «bâtiments fermés qui surplombent les rues vides»). Dans son infructueux périple à la recherche d’un abri, Filippo Rubè est assailli par les souvenirs confus, des images et des sons, du champ de bataille, pourtant désormais lointain et le protagoniste a le sentiment de battre le pavé au pas de marche et de continuer à participer à des assauts sur une improbable ligne de front, imaginant sous la terre « […] des millions et des millions de nains muets, à demi ensevelis, en train de griffer la terre de leurs ongles et y enfonçant des engins pour faire sauter le monde». Le monologue intérieur qui scande ses pérégrinations (et qui l’accompagne tout au long du livre) ressasse des imprécations autour de l’indignité («bella maniera porca» lit-on dans la version originale) avec laquelle on accueille «[…] les sauveurs de la civilisation occidentale».

En effet, outre la perspective historique – et éthique – que dessinent les échappées puis les errances du protagoniste, le langage du roman de Borgese permet de tracer un portrait à la fois enlevé et tragique d’un anti-héros à la Thomas Mann mâtiné de Stendhal, qui pourrait annoncer les incertitudes de la lost generation (Rubè fut traduit aux USA dès 1923 et apprécié par Hemingway) [[On pourrait citer les hallucinations de Septimus (dans Mrs Dalloway de Virginia Woolf, paru en 1925), lui aussi blessé en Italie durant la guerre : «Il était seul, exposé sur cette pâle hauteur étendu – mais pas en haut d’une colline ; pas sur un rocher escarpé: sur le canapé du salon de Mrs Filmer. Quant aux visions, aux visages, aux voix des morts, où étaient-ils ? Il y avait un paravent devant lui, avec des joncs noirs et des hirondelles bleues. Là où il avait vu des montagnes, des visages, là où il avait vu la beauté, il y avait un paravent.» (p. 166, Le livre de poche, 2012).]]. C’est sans doute sa prolixité qui ne plut ni au public italien de l’époque de sa publication, qui appréciait plutôt les subtilités du frammento d’arte ou les perplexités sur les «avatars du moi» de Pirandello, ni aux lecteurs des années suivantes (le livre fut republié en 1928, 1930 et 1933, puis en 1946), désormais largement intéressés au néoréalisme et aux leçons de l’histoire, refusant donc le «décadentisme» des personnages et la charge de désespérance à laquelle font allusion les situations. Le livre, qui s’inscrit dans l’histoire littéraire, se trouvait donc «en décalage», entre deux époques.
Le périple de cinq ans que décrit Rubè tout au long du roman permet de le suivre à travers l’Italie, de la Sicile natale à Rome, puis en Vénétie et, après un séjour à Paris, à Milan, de nouveau en Vénétie, en Toscane, en Sicile et de nouveau à Rome et Milan, pour finir à Bologne. Cette errance à la recherche de soi-même dans une Italie qui n’en finit pas de tenter d’achever sa construction (la guerre devait parachever l’Unité, mais la société en sort plus divisée que jamais) permet de montrer aussi bien le mal de vivre du protagoniste que celui d’un pays qui au sortir du conflit mondial se trouve en proie à une «drôle de guerre»… civile. Aujourd’hui, on voit que le destin de Filippo Rubè est en quelque sorte un éclat de celui que connaissait l’Italie: une tragédie larvée qui se confirmera avec le succès imminent du fascisme. Toutefois, la lecture de la ligne de vie erratique de cet anti-héros qu’est Rubè va au-delà d’une lecture orientée par des considérations socio-historiques: l’écriture de Borgese décrit le monde dans lequel se déplacent les personnages avec une vraie présence, une chair, pour le dire avec Merleau-Ponty, comme dans ce passage où le regard d’Eugenia, que Filippo vient de quitter, s’arrête sur une ampoule qui tout à coup devient un signe parlant du destin :
[…] La lampe laissée allumée par le fugitif sur le petit bureau se faisait plus jaune dans la lumière du petit matin et rendait l’horreur plus intense. Ses yeux fascinés, qui à cet instant étaient comme sans paupières, ne quittaient plus le fil métallique de l’ampoule qui dessinait et entremêlait des V et des M lumineux. Vie, Mort, Mort, Vie. […]
Le chiasme qui clôt le récit de la vision d’Eugenia est représentatif de ces effets de réel dont est ponctué le roman, où un détail extérieur entre en résonance avec un état d’âme. Par exemple, en pensant à la silhouette de la femme aimée, Filippo en vient à ressentir cette «chair du monde», l’invisible qui transmet à la fois l’émotion de la passion, l’oubli douloureux de soi et des autres et une mélancolie perturbante :
[…] Comment était donc l’arc de ses sourcils, si minces et pourtant si marqués? Et le creux de sa nuque, profond au toucher, mais d’une couleur si douce que l’œil ne le percevait pas? Il se tourmentait, fouillait dans sa mémoire jusqu’à ce que les ligne se confondissent toutes, et il en arrivait presque à penser que, s’il l’avait rencontrée, il ne l’aurait peut-être pas reconnue. Mais n’en était-il pas ainsi de toutes les choses de sa vie? Même du paysage qui était là, inchangé depuis des jours devant lui; s’il fermait les yeux et s’efforçait de le reconstituer mentalement, il ne ressentait plus que le ton ardent des pics et la noirceur lugubre des forêts. […]
Ce que l’on ressent à la lecture, c’est, comme l’évoque parfaitement la traductrice, une écriture où la prolifération de l’image «[…] correspond certainement à cette présence toujours plus menacée des identités» qui était dans l’air du temps. Il s’agit là d’un roman attachant parce qu’il fait éprouver, dans la chair de l’écriture même outre que dans les gestes des protagonistes, la tentative de saisir «une réalité qui s’échappe», pour reprendre une expression de Borgese lui-même.
Jean Nimis
(Université de Toulouse 2)
Présentation de l’éditeur:
Giuseppe Antonio Borgese
Vie de Filippo Rubè
Traduit de l’italien, présenté et annoté par Muriel Gallot
L’Imaginaire Gallimard n°664
462p / 13,90€
Premier roman de Borgese, la “Vie de Filippo Rubé” (1921) est un grand classique romanesque, situé à l’époque de la première Guerre mondiale. Courte vie, à laquelle le protagoniste, avec une lucidité stendhalienne, va tenter de trouver un sens, dans un monde où la peur, la mort, le courage tressent un réseau inextricable.
Dans cette errance, trois femmes prendront le visage de son destin: Eugenia, Mary et Célestine, dont les figures s’organisent en un bouquet sublime. Borgese rêvait de créer des “fables pour l’imagination des foules qui soient aussi des modèles ardus de styles pour les artistes”. Cette ambition trouve ici son accomplissement. Chant du cygne du roman, la “Vie de Filippo Rubè” attendait notre siècle pour retrouver des lecteurs à qui offrir son merveilleux pouvoir d’identification.